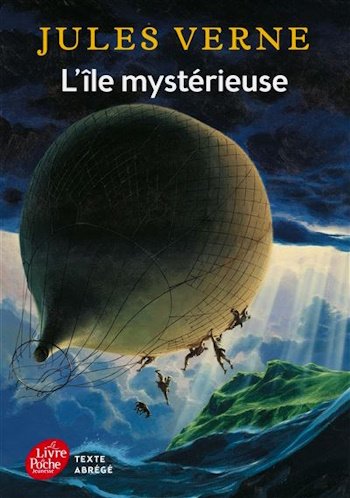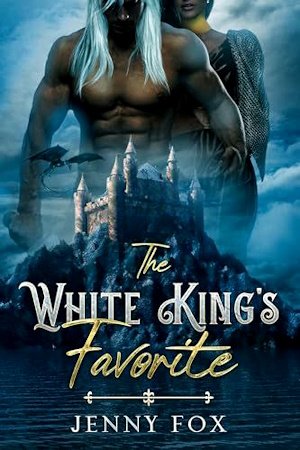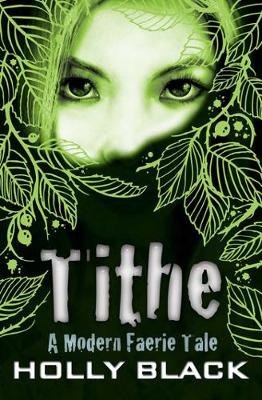« Maladroit que je suis ! s’écria Harbert.
– Eh non, mon garçon ! répondit le marin. Le coup était bien porté, et plus d’un aurait manqué l’oiseau. Allons ! ne vous dépitez pas ! Nous le rattraperons un autre jour ! »
L’exploration continua. À mesure que les chasseurs s’avançaient, les arbres, plus espacés, devenaient magnifiques, mais aucun ne produisait de fruits comestibles. Pencroff cherchait vainement quelques-uns de ces précieux palmiers qui se prêtent à tant d’usages de la vie domestique, et dont la présence a été signalée jusqu’au quarantième parallèle dans l’hémisphère boréal et jusqu’au trente-cinquième seulement dans l’hémisphère austral.
Mais cette forêt ne se composait que de conifères, tels que les déodars, déjà reconnus par Harbert, des « douglas », semblables à ceux qui poussent sur la côte nord-ouest de l’Amérique, et des sapins admirables, mesurant cent cinquante pieds de hauteur. En ce moment, une volée d’oiseaux de petite taille et d’un joli plumage, à queue longue et chatoyante, s’éparpillèrent entre les branches, semant leurs plumes, faiblement attachées, qui couvrirent le sol d’un fin duvet. Harbert ramassa quelques-unes de ces plumes, et, après les avoir examinées :
« Ce sont des « couroucous », dit-il.
– Je leur préférerais une pintade ou un coq de bruyère, répondit Pencroff ; mais enfin, s’ils sont bons à manger ?…
– Ils sont bons à manger, et même leur chair est très délicate, reprit Harbert. D’ailleurs, si je ne me trompe, il est facile de les approcher et de les tuer à coups de bâton. »
Le marin et le jeune garçon, se glissant entre les herbes, arrivèrent au pied d’un arbre dont les basses branches étaient couvertes de petits oiseaux. Ces couroucous attendaient au passage les insectes qui leur servent de nourriture. On voyait leurs pattes emplumées serrer fortement les pousses moyennes qui leur servaient d’appui.
Les chasseurs se redressèrent alors, et, avec leurs bâtons manœuvrés comme une faux, ils rasèrent des files entières de ces couroucous, qui ne songeaient point à s’envoler et se laissèrent stupidement abattre. Une centaine jonchait déjà le sol, quand les autres se décidèrent à fuir.
« Bien, dit Pencroff, voilà un gibier tout à fait à la portée de chasseurs tels que nous ! On le prendrait à la main ! »
Le marin enfila les couroucous, comme des mauviettes, au moyen d’une baguette flexible, et l’exploration continua. On put observer que le cours d’eau s’arrondissait légèrement, de manière à former un crochet vers le sud, mais ce détour ne se prolongeait vraisemblablement pas, car la rivière devait prendre sa source dans la montagne et s’alimenter de la fonte des neiges qui tapissaient les flancs du cône central.
L’objet particulier de cette excursion était, on le sait, de procurer aux hôtes des Cheminées la plus grande quantité possible de gibier. On ne pouvait dire que le but jusqu’ici eût été atteint. Aussi le marin poursuivait-il activement ses recherches, et maugréait-il quand quelque animal, qu’il n’avait pas même le temps de reconnaître, s’enfuyait entre les hautes herbes. Si encore il avait eu le chien Top !
Mais Top avait disparu en même temps que son maître et probablement péri avec lui !
Vers trois heures après midi, de nouvelles bandes d’oiseaux furent entrevues à travers certains arbres, dont ils becquetaient les baies aromatiques, entre autres des genévriers. Soudain, un véritable appel de trompette résonna dans la forêt. Ces étranges et sonores fanfares étaient produites par ces gallinacés que l’on nomme « tétras » aux États-Unis.
Bientôt on en vit quelques couples, au plumage varié de fauve et de brun, et à la queue brune. Harbert reconnut les mâles aux deux ailerons pointus, formés par les pennes relevées de leur cou. Pencroff jugea indispensable de s’emparer de l’un de ces gallinacés, gros comme une poule, et dont la chair vaut celle de la gélinotte. Mais c’était difficile, car ils ne se laissaient point approcher. Après plusieurs tentatives infructueuses, qui n’eurent d’autre résultat que d’effrayer les tétras, le marin dit au jeune garçon :
« Décidément, puisqu’on ne peut les tuer au vol, il faut essayer de les prendre à la ligne.
– Comme une carpe ? s’écria Harbert, très surpris de la proposition.
– Comme une carpe », répondit sérieusement le marin.
Pencroff avait trouvé dans les herbes une demi-douzaine de nids de tétras, ayant chacun de deux à trois œufs. Il eut grand soin de ne pas toucher à ces nids, auxquels leurs propriétaires ne pouvaient manquer de revenir. Ce fut autour d’eux qu’il imagina de tendre ses lignes, – non des lignes à collets, mais de véritables lignes à hameçon. Il emmena Harbert à quelque distance des nids, et là il prépara ses engins singuliers avec le soin qu’eût apporté un disciple d’Isaac Walton. Harbert suivait ce travail avec un intérêt facile à comprendre, tout en doutant de la réussite. Les lignes furent faites de minces lianes, rattachées l’une à l’autre et longues de quinze à vingt pieds. De grosses épines très fortes, à pointes recourbées, que fournit un buisson d’acacias nains, furent liées aux extrémités des lianes en guise d’hameçon. Quant à l’appât, de gros vers rouges qui rampaient sur le sol en tinrent lieu.
Cela fait, Pencroff, passant entre les herbes et se dissimulant avec adresse, alla placer le bout de ses lignes armées d’hameçons près des nids de tétras ; puis il revint prendre l’autre bout et se cacha avec Harbert derrière un gros arbre. Tous deux alors attendirent patiemment. Harbert, il faut le dire, ne comptait pas beaucoup sur le succès de l’inventif Pencroff. Une grande demi-heure s’écoula, mais, ainsi que l’avait prévu le marin, plusieurs couples de tétras revinrent à leurs nids. Ils sautillaient, becquetant le sol, et ne pressentant en aucune façon la présence des chasseurs, qui, d’ailleurs, avaient eu soin de se placer sous le vent des gallinacés.
Certes, le jeune garçon, à ce moment, se sentit intéressé très vivement. Il retenait son souffle, et Pencroff, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, les lèvres avancées comme s’il allait goûter un morceau de tétras, respirait à peine.
Cependant, les gallinacés se promenaient entre les hameçons, sans trop s’en préoccuper. Pencroff alors donna de petites secousses qui agitèrent les appâts, comme si les vers eussent été encore vivants.
À coup sûr, le marin, en ce moment, éprouvait une émotion bien autrement forte que celle du pêcheur à la ligne, qui, lui, ne voit pas venir sa proie à travers les eaux.
Les secousses éveillèrent bientôt l’attention des gallinacés, et les hameçons furent attaqués à coups de bec. Trois tétras, très voraces sans doute, avalèrent à la fois l’appât et l’hameçon. Soudain, d’un coup sec, Pencroff « ferra » son engin, et des battements d’aile lui indiquèrent que les oiseaux étaient pris.
« Hurrah ! » s’écria-t-il en se précipitant vers ce gibier, dont il se rendit maître en un instant.
Harbert avait battu des mains. C’était la première fois qu’il voyait prendre des oiseaux à la ligne, mais le marin, très modeste, lui affirma qu’il n’en était pas à son coup d’essai, et que, d’ailleurs, il n’avait pas le mérite de l’invention.
« Et en tout cas, ajouta-t-il, dans la situation où nous sommes, il faut nous attendre à en voir bien d’autres ! »
Les tétras furent attachés par les pattes, et Pencroff, heureux de ne point revenir les mains vides et voyant que le jour commençait à baisser, jugea convenable de retourner à sa demeure.
La direction à suivre était tout indiquée par celle de la rivière, dont il ne s’agissait que de redescendre le cours, et, vers six heures, assez fatigués de leur excursion, Harbert et Pencroff rentraient aux Cheminées.
CHAPITRE VII
Gédéon Spilett, immobile, les bras croisés, était alors sur la grève, regardant la mer, dont l’horizon se confondait dans l’est avec un gros nuage noir qui montait rapidement vers le zénith. Le vent était déjà fort, et il fraîchissait avec le déclin du jour. Tout le ciel avait un mauvais aspect, et les premiers symptômes d’un coup de vent se manifestaient visiblement.
Harbert entra dans les Cheminées, et Pencroff se dirigea vers le reporter. Celui-ci, très absorbé, ne le vit pas venir.
« Nous allons avoir une mauvaise nuit, Monsieur Spilett ! dit le marin. De la pluie et du vent à faire la joie des pétrels ! »
Le reporter, se retournant alors, aperçut Pencroff, et ses premières paroles furent celles-ci :
« À quelle distance de la côte la nacelle a-t-elle, selon vous, reçu ce coup de mer qui a emporté notre compagnon ? »
Le marin ne s’attendait pas à cette question. Il réfléchit un instant et répondit :
« À deux encablures, au plus.
– Mais qu’est-ce qu’une encablure ? demanda Gédéon Spilett.
– Cent vingt brasses environ ou six cents pieds.
– Ainsi, dit le reporter, Cyrus Smith aurait disparu à douze cents pieds au plus du rivage ?