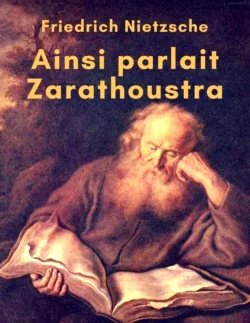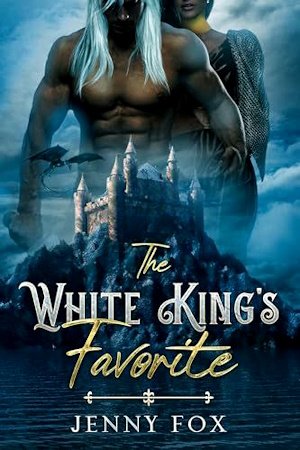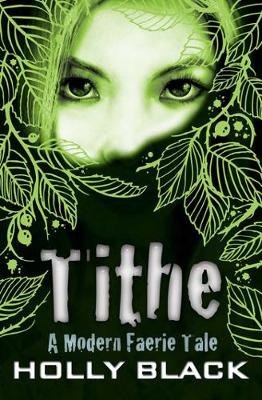Trop longtemps mon âme affamée fut assise à table, je ne suis pas comme eux, dressé
pour la connaissance comme pour casser des noix.
J’aime la liberté et l’air sur la terre fraîche ; j’aime encore mieux dormir sur les peaux
de bœufs que sur leurs honneurs et leurs dignités.
Je suis trop ardent et trop consumé de mes propres pensées : j’y perds souvent haleine.
Alors il me faut aller au grand air et quitter les chambres pleines de poussière.
Mais ils sont assis au frais, à l’ombre fraîche : ils veulent partout n’être que des spectateurs et se gardent bien de s’asseoir où le soleil darde sur les marches.
Semblables à ceux qui stationnent dans la rue et qui bouche bée regardent les gens qui
passent : ainsi ils attendent aussi, bouche bée, les pensées des autres.
Les touche-t-on de la main, ils font involontairement de la poussière autour d’eux, comme des sacs de farine ; mais qui donc se douterait que leur poussière vient du grain et
de la jeune félicité des champs d’été ?
S’ils se montrent sages, je suis horripilé de leurs petites sentences et de leurs vérités : leur sagesse a souvent une odeur de marécage : et, en vérité, j’ai déjà entendu les grenouilles coasser dans leur sagesse !
Ils sont adroits et leurs doigts sont agiles : que veut ma simplicité auprès de leur complexité ! Leurs doigts s’entendent à tout ce qui est filage et nouage et tissage : ainsi ils tricotent les bas de l’esprit !
Ce sont de bonnes pendules : pourvu que l’on ait soin de les bien remonter ! Alors elles
indiquent l’heure sans se tromper et font entendre en même temps un modeste tic-tac.
Ils travaillent, semblables à des moulins et à des pilons : qu’on leur jette seulement du
grain ! – ils s’entendent à moudre le grain et à le transformer en blanche farine.
Avec méfiance, ils se surveillent les doigts les uns aux autres. Inventifs et petites malices, ils épient ceux dont la science est boiteuse – ils guettent comme des araignées.
Je les ai toujours vus préparer leurs poisons avec précaution ; et toujours ils couvraient
leurs doigts de gants de verre.
Ils savent aussi jouer avec des dés pipés ; et je les ai vus jouer avec tant d’ardeur qu’ils en étaient couverts de sueur.
Nous sommes étrangers les uns aux autres et leurs vertus me sont encore plus contraires
que leurs faussetés et leurs dés pipés.
Et lorsque je demeurais parmi eux, je demeurais au-dessus d’eux. C’est pour cela qu’ils
m’en ont voulu.
Ils ne veulent pas qu’on leur dise que quelqu’un marche au-dessus de leurs têtes ; et c’est pourquoi ils ont mis du bois, de la terre et des ordures, entre moi et leurs têtes.
Ainsi ils ont étouffé le bruit de mes pas ; et jusqu’à présent ce sont les plus savants qui m’ont le moins bien entendu.
Ils ont mis entre eux et moi toutes les faiblesses et toutes les fautes des hommes : – dans leurs demeures ils appellent cela « faux plancher ».
Mais malgré tout je marche au-dessus de leur tête avec mes pensées ; et si je voulais même marcher sur mes propres défauts, je marcherais encore au-dessus d’eux et de leur tête.
Car les hommes ne sont point égaux : ainsi parle la justice. Et ce que je veux ils n’auraient pas le droit de le vouloir ! –
Ainsi parlait Zarathoustra.
Des poètes
« Depuis que je connais mieux le corps, – disait Zarathoustra à l’un de ses disciples –
l’esprit n’est plus pour moi esprit que dans une certaine mesure ; et tout ce qui est
« impérissable » – n’est aussi que symbole. »
« Je t’ai déjà entendu parler ainsi, répondit le disciple ; et alors tu as ajouté : « Mais les poètes mentent trop. » Pourquoi donc disais-tu que les poètes mentent trop ? »
« Pourquoi ? dit Zarathoustra. Tu demandes pourquoi ? Je ne suis pas de ceux qu’on a le
droit de questionner sur leur pourquoi.
Ce que j’ai vécu est-il donc d’hier ? Il y a longtemps que j’ai vécu les raisons de mes
opinions.