« On aurait dit qu’elle cachait quelque chose. » Mais Alphonse avait couru, il s’était fau lé entre les jambes de Louise et il avait rejoint les enfants, encore en pyjama, assis devant la télévision. « J’ai essayé de la convaincre. Je lui ai dit qu’on pourrait sortir, faire une promenade.
Il faisait beau et les enfants allaient s’ennuyer. » Louise n’avait rien voulu entendre. « Elle ne m’a pas laissée entrer. J’ai appelé Alphonse, qui était très déçu, et nous sommes partis. »
Mais Louise n’est pas restée dans l’appartement. Rose Grinberg est formelle, elle a rencontré la nounou dans le hall de l’immeuble, une heure avant sa sieste. Une heure avant le meurtre. D’où venait Louise ? Où était-elle allée ? Combien de temps est-elle restée dehors ? Les policiers ont fait le tour du quartier, la photo de Louise à la main. Ils ont interrogé tout le monde. Ils ont dû faire taire les menteurs, les solitaires qui fabulent pour faire passer le temps. Ils sont allés au square, au café Le Paradis, ils ont marché dans les passages de la rue du Faubourg-Saint-Denis et ont questionné les commerçants. Et puis ils ont retrouvé cette vidéo du supermarché.
Mille fois, le capitaine a repassé l’enregistrement. Elle a regardé jusqu’à la nausée la tranquille démarche de Louise dans les rayons.
Elle a observé ses mains, ses toutes petites mains, qui se saisissaient d’un pack de lait, d’un paquet de biscuits et d’une bouteille de vin.
Sur ces images, les enfants courent d’un rayon à l’autre sans que la nounou les suive des yeux. Adam fait tomber des paquets, il se cogne aux genoux d’une femme qui pousse un caddie. Mila essaie
d’attraper des œufs en chocolat. Louise est calme, elle n’ouvre pas la bouche, elle ne les appelle pas. Elle se dirige vers la caisse et ce sont eux qui reviennent vers elle, en riant. Ils se jettent entre ses jambes, Adam tire sur sa jupe, mais Louise les ignore. À peine montre-t-elle quelques signes d’agacement, que la policière devine, une légère contraction de la lèvre, un regard furtif, par en dessous. Louise, se dit la policière, ressemble à ces mères duplices qui, dans les contes, abandonnent leurs enfants aux ténèbres d’une forêt.
À 16 heures, Rose Grinberg a fermé les volets. Wafa a marché jusqu’au square et elle s’est assise sur un banc. Hervé a terminé son service. C’est à cette heure-là que Louise s’est dirigée vers la salle de bains. Demain, Nina Dorval devra répéter les mêmes gestes : ouvrir le robinet, laisser sa main sous le let d’eau pour évaluer la température comme elle le faisait pour ses propres ls, quand ils étaient encore petits. Et elle dira : « Les enfants, venez. Vous allez prendre un bain. »
Il a fallu demander à Paul si Adam et Mila aimaient l’eau. S’ils étaient réticents, en général, avant de se déshabiller. S’ils prenaient du plaisir à barboter au milieu de leurs jouets. « Une dispute a pu éclater, a expliqué le capitaine. Pensez-vous qu’ils aient pu se mé er ou plutôt s’étonner de prendre un bain à 4 heures de l’après-midi ? »
On a montré au père la photo de l’arme du crime. Un couteau de cuisine, banal mais si petit que Louise avait sans doute pu le dissimuler en partie dans sa paume. Nina lui a demandé s’il le reconnaissait. S’il était à eux ou si Louise l’avait acheté, si elle avait prémédité son geste. « Prenez votre temps », a-t-elle dit. Mais Paul n’a pas eu besoin de temps. Ce couteau, c’est celui que Thomas leur avait apporté en cadeau du Japon. Un couteau en céramique,
extrêmement aiguisé, dont le simple contact pouvait su re à entailler la pulpe des doigts. Un couteau à sushi en échange duquel Myriam lui avait donné une pièce d’un euro, pour conjurer le mauvais sort.
« Mais on ne l’utilisait jamais pour la cuisine. Myriam l’avait rangé dans un placard, en hauteur. Elle voulait le tenir hors de portée des enfants. »
Après deux mois d’enquête, nuit et jour, deux mois à traquer le passé de cette femme, Nina se met à croire qu’elle connaît Louise mieux que quiconque. Elle a convoqué Bertrand Alizard. L’homme tremblait sur son fauteuil dans le bureau du 36. Des gouttes de sueur coulaient sur ses taches de son. Lui, qui a si peur du sang et des mauvaises surprises, est resté dans le couloir quand la police a fouillé le studio de Louise. Les tiroirs étaient vides, les vitres immaculées.
Ils n’y ont rien trouvé. Rien qu’une vieille photo de Stéphanie et quelques enveloppes encore fermées.
Nina Dorval a plongé les mains dans l’âme pourrissante de Louise. D’elle, elle a voulu tout savoir. Elle a cru pouvoir briser à coups de poing le mur de mutisme dans lequel la nounou s’était piégée. Elle a interrogé les Rouvier, M. Franck, Mme Perrin, les médecins de l’hôpital Henri-Mondor, où Louise avait été admise pour des troubles de l’humeur. Elle a lu pendant des heures le carnet à couverture eurie et elle rêvait, la nuit, de ces lettres tordues, de ces noms inconnus que Louise avait notés avec une application d’enfant solitaire. Le capitaine a retrouvé des voisins du temps où Louise vivait dans la maison de Bobigny. Elle a posé des questions aux nounous du square. Personne ne semblait la cerner. « C’était bonjour, bonsoir, rien de plus. » Rien à signaler.
Et puis, elle a regardé dormir la prévenue sur son lit blanc. Elle a
demandé à l’in rmière de sortir de la chambre. Elle voulait être seule avec la poupée vieillissante. La poupée endormie, portant sur le cou et les mains, en guise de bijoux, d’épais pansements blancs. Sous la lumière des néons, le capitaine xait les paupières blêmes, les racines grises sur les tempes et la faible pulsation d’une veine qui battait sous le lobe de l’oreille. Elle tentait de lire quelque chose sur ce visage e ondré, sur cette peau sèche où les rides avaient creusé des rigoles. Le capitaine n’a pas touché le corps immobile mais elle s’est assise et elle a parlé à Louise comme on parle aux enfants qui font semblant de dormir. Elle lui a dit : « Je sais que tu m’entends. »
Nina Dorval en a fait l’expérience : les reconstitutions agissent parfois comme un révélateur, comme ces cérémonies vaudoues où la transe fait jaillir une vérité dans la douleur, où le passé s’éclaire d’une lumière nouvelle. Une fois sur scène, il arrive que la magie opère, qu’un détail apparaisse, qu’une contradiction prenne en n sens.
Demain, elle entrera dans l’immeuble de la rue d’Hauteville devant lequel fanent encore quelques bouquets de eurs et des dessins d’enfants.
Elle
contournera
les
bougies
et
prendra
l’ascenseur. L’appartement, où rien n’a changé depuis ce jour de mai, où personne n’est venu chercher des a aires ou même récupérer des papiers, sera la scène de ce théâtre sordide. Nina Dorval frappera les trois coups.
Là, elle se laissera engloutir dans une vague de dégoût, dans la détestation de tout, cet appartement, cette machine à laver, cet évier toujours sale, ces jouets qui s’échappent de leurs boîtes et qui viennent mourir sous les tables, l’épée pointée vers le ciel, l’oreille pendante. Elle sera Louise, Louise qui enfonce ses doigts dans ses oreilles pour faire cesser les cris et les pleurs. Louise qui fait l’aller-
retour de la chambre à la cuisine, de la salle de bains à la cuisine, de la poubelle au sèche-linge, du lit au placard de l’entrée, du balcon à la salle de bains. Louise qui revient et puis qui recommence, Louise qui se baisse et se met sur la pointe des pieds. Louise qui saisit un couteau dans un placard. Louise qui boit un verre de vin, la fenêtre ouverte, un pied sur le petit balcon.
« Les enfants, venez. Vous allez prendre un bain. »
© Éditions Gallimard, 2016.
LEÏLA SLIMANI
Chanson douce
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l’affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu’au drame.
À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c’est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l’amour et de l’éducation, des rapports de domination et d’argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.
Leïla Slimani est née en 1981. Elle est l’auteur d’unpremier roman très remarqué, Dans le jardin de l’ogre (« Folio » no 6062), paru en 2014 aux Éditions Gallimard, dans la collection « Blanche ».
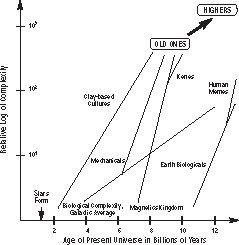
DU MÊME AUTEUR
Aux Éditions Gallimard
o
DANS LE JARDIN DE L’OGRE, roman, 2014 (« Folio » n 6062).









