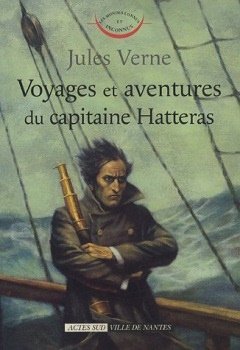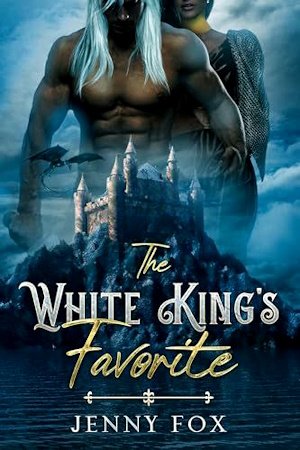– Il finira nécessairement par les connaître, car nous ne pouvons pas le laisser seul ici ?
– Et pourquoi ? demanda le capitaine avec une certaine violence ; ne peut-il demeurer au Fort-Providence ?
– Il n’y consentirait pas, Hatteras ; et puis abandonner cet homme que nous ne serions pas certains de retrouver au retour, ce serait plus qu’imprudent, ce serait inhumain ; Altamont viendra, il faut qu’il vienne ! mais, comme il est inutile de lui donner maintenant des idées qu’il n’a pas, ne lui disons rien, et construisons une chaloupe destinée en apparence à la reconnaissance de ces nouveaux rivages.
Hatteras ne pouvait se décider à se rendre aux idées de son ami ; celui-ci attendait une réponse qui ne se faisait pas.
– Et si cet homme refusait de consentir au dépeçage de son navire ? dit enfin le capitaine.
– Dans ce cas, vous auriez le bon droit pour vous ; vous construiriez cette chaloupe malgré lui, et il n’aurait plus rien à prétendre.
– Fasse donc le Ciel qu’il refuse ! s’écria Hatteras.
– Avant un refus, répondit le docteur, il faut une demande ; je me charge de la faire.
En effet, le soir même, au souper, Clawbonny amena la conversation sur certains projets d’excursions pendant les mois d’été, destinées à faire le relevé hydrographique des côtes.
– Je pense, Altamont, dit-il, que vous serez des nôtres ?
– Certes, répondit l’Américain, il faut bien savoir jusqu’où s’étend cette terre de la Nouvelle-Amérique.
Hatteras regardait son rival fixement pendant qu’il répondait ainsi.
– Et pour cela, reprit Altamont, il faut faire le meilleur emploi possible des débris du Porpoise ; construisons donc une chaloupe solide et qui nous porte loin.
– Vous entendez, Bell, dit vivement le docteur, dès demain nous nous mettrons à l’ouvrage.
Chapitre 15 LE PASSAGE DU NORD-OUEST
Le lendemain, Bell, Altamont et le docteur se rendirent au Porpoise ; le bois ne manquait pas ; l’ancienne chaloupe du trois-mâts, défoncée par le choc des glaçons, pouvait encore fournir les parties principales de la nouvelle. Le charpentier se mit donc immédiatement à l’œuvre ; il fallait une embarcation capable de tenir la mer, et cependant assez légère pour pouvoir être transportée sur le traîneau. Pendant les derniers jours de mai, la température s’éleva ; le thermomètre remonta au degré de congélation ; le printemps revint pour tout de bon, cette fois, et les hiverneurs durent quitter leurs vêtements d’hiver.
Les pluies étaient fréquentes ; la neige commença bientôt à profiter des moindres déclivités du terrain pour s’en aller en chutes et en cascades.
Hatteras ne put contenir sa satisfaction en voyant les champs de glace donner les premiers signes de dégel. La mer libre, c’était pour lui la liberté.
Si ses devanciers se trompèrent ou non sur cette grande question du bassin polaire, c’est ce qu’il espérait savoir avant peu. De là dépendait tout le succès de son entreprise.
Un soir, après une assez chaude journée, pendant laquelle les symptômes de décomposition des glaces s’accusèrent plus manifestement, il mit la conversation sur ce sujet si intéressant de la mer libre.
Il reprit la série des arguments qui lui étaient familiers, et trouva comme toujours dans le docteur un chaud partisan de sa doctrine. D’ailleurs ses conclusions ne manquaient pas de justesse.
– Il est évident, dit-il, que si l’Océan se débarrasse de ses glaces devant la baie Victoria, sa partie méridionale sera également libre jusqu’au Nouveau-Cornouailles et jusqu’au canal de la Reine. Penny et Belcher l’ont vu tel, et ils ont certainement bien vu.
– Je le crois comme vous, Hatteras, répondit le docteur, et rien n’autorisait à mettre en doute la bonne foi de ces illustres marins ; on tentait vainement d’expliquer leur découverte par un effet du mirage ; mais ils se montraient trop affirmatifs pour ne pas être certains du fait.
– J’ai toujours pensé de cette façon, dit Altamont, qui prit alors la parole ; le bassin polaire s’étend non seulement dans l’ouest, mais aussi dans l’est.
– On peut le supposer, en effet, répondit Hatteras.
– On doit le supposer, reprit l’Américain, car cette mer libre, que les capitaines Penny et Belcher ont vue près des côtes de la terre Grinnel, Morton, le lieutenant de Kane, l’a également aperçue dans le détroit qui porte le nom de ce hardi savant !
– Nous ne sommes pas dans la mer de Kane, répondit sèchement Hatteras, et par conséquent nous ne pouvons vérifier le fait.
– Il est supposable, du moins, dit Altamont.
– Certainement, répliqua le docteur, qui voulait éviter une discussion inutile. Ce que pense Altamont doit être la vérité ; à moins de dispositions particulières des terrains environnants, les mêmes effets se produisent sous les mêmes latitudes. Aussi, je crois à la mer libre dans l’est aussi bien que dans l’ouest.
– En tout cas, peu nous importe ! dit Hatteras.
– Je ne dis pas comme vous, Hatteras, reprit l’Américain, que l’indifférence affectée du capitaine commençait à échauffer, cela pourra avoir pour nous une certaine importance !
– Et quand, je vous prie ?
– Quand nous songerons au retour.
– Au retour ! s’écria Hatteras. Et qui y pense ?
– Personne, répondit Altamont, mais enfin nous nous arrêterons quelque part, je suppose.
– Où cela ? fit Hatteras.
Pour la première fois, cette question était directement posée à l’Américain. Le docteur eût donné un de ses bras pour arrêter net la discussion.
Altamont ne répondant pas, le capitaine renouvela sa demande.
– Où cela ? fit-il en insistant.
– Où nous allons ! répondit tranquillement l’Américain.