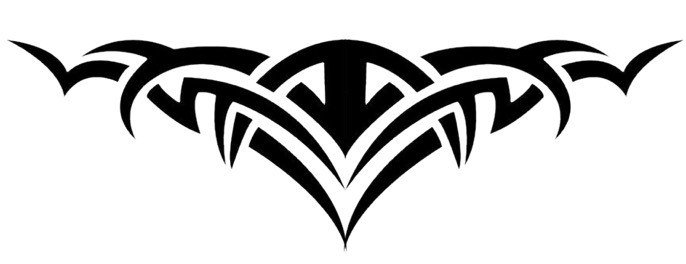
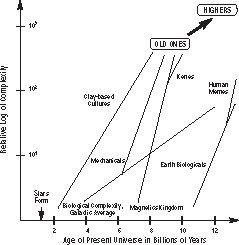
La vérité sur l’affaire Harry Quebert
de
Joël Dicker
À mes parents
Le jour de la disparition
(samedi 30 août 1975)
- Centrale de la police, quel e est votre urgence ?
- Allô ? Mon nom est Deborah Cooper, j’habite à Side Creek Lane. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt.
- Que s’est-il passé exactement ?
- Je ne sais pas ! J’étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois et là, j’ai vu cette jeune fille qui courait entre les arbres… Il y avait un homme derrière el e… Je crois qu’el e essayait de lui échapper.
- Où sont-ils à présent ?
- Je… Je ne les vois plus. Ils sont dans la forêt.
- Je vous envoie immédiatement une patrouil e, Madame.
C’est par cet appel que débuta le fait divers qui secoua la ville d’Aurora, dans le New Hampshire. Ce jour-là, Nola Kellergan, quinze ans, une jeune fille de la région, disparut. On ne retrouva plus jamais sa trace.
Prologue
Octobre 2008
(33 ans après la disparition)
Tout le monde parlait du livre. Dans les rues de New York, je ne pouvais plus déambuler en paix, je ne pouvais plus faire mon jogging dans les allées de Central Park sans que des promeneurs me reconnaissent et s’exclament : « Hé, c’est Goldman !
C’est l’écrivain ! » Il arrivait même que certains entament quelques pas de course pour me suivre et me poser les questions qui les taraudaient : « Ce que vous y dites, dans votre bouquin, c’est la vérité ? Harry Quebert a vraiment fait ça ? » Dans le café de West Village où j’avais mes habitudes, certains clients n’hésitaient plus à s’asseoir à ma table pour me parler : « Je suis en train de lire votre livre, Monsieur Goldman : je ne peux pas m’arrêter ! Le premier était déjà bon, mais alors celui-là ! On vous a vraiment filé un mil ion de dollars pour l’écrire ? Vous avez quel âge ? Trente ans à peine ?
Trente ans ! Et vous avez déjà amassé tellement de pognon ! » Même le portier de mon immeuble, que je voyais avancer dans sa lecture entre deux ouvertures de portes, avait fini par me coincer longuement devant l’ascenseur, une fois le livre terminé, pour me confier ce qu’il avait sur le cœur : « Alors, voilà ce qui est arrivé à Nola Kellergan ?
Quel e horreur ! Mais comment en arrive-t-on là ? Hein, Monsieur Goldman, comment est-ce possible ? »
Le Tout-New York se passionnait pour mon livre; il y avait deux semaines qu’il était paru et il promettait déjà d’être la meilleure vente de l’année sur le continent américain. Tout le monde voulait savoir ce qui s’était passé à Aurora en 1975. On en parlait partout : à la télévision, à la radio, dans les journaux. J’avais à peine trente ans et avec ce livre, qui était seulement le deuxième de ma carrière, j’étais devenu l’écrivain le plus en vue du pays.
L’affaire qui agitait l’Amérique, et dont j’avais tiré l’essence de mon récit, avait éclaté quelques mois plus tôt, au début de l’été, lorsqu’on avait retrouvé les restes d’une jeune fille disparue depuis trente-trois ans. C’est ainsi que débutèrent les événements du New Hampshire qui vont être rapportés ici, et sans lesquels la petite ville d’Aurora serait certainement demeurée inconnue du reste de l’Amérique.
PREMIÈRE PARTIE
La maladie des écrivains
(8 mois avant la sortie du livre)
31. Dans les abîmes de la mémoire
“Le premier chapitre, Marcus, est essentiel. Si les lecteurs ne l’aiment pas, ils ne liront pas le reste de votre livre. Par quoi comptez-vous commencer le vôtre ?
- Je ne sais pas, Harry. Vous pensez qu’un jour j’y arriverai ?
- À quoi ?
- À écrire un livre.
- J’en suis certain.”
Au début de l’année 2008, soit environ un an et demi après être devenu, grâce à mon premier roman, la nouvelle coqueluche des lettres américaines, je fus frappé d’une terrible crise de page blanche, syndrome qui, paraît-il, n’est pas rare chez les écrivains ayant connu un succès immédiat et fracassant. La maladie n’était pas venue d’un coup : elle s’était instal ée en moi lentement. C’était comme si mon cerveau, atteint, s’était figé peu à peu. À l’apparition des premiers symptômes, je n’avais pas voulu y prêter attention : je m’étais dit que l’inspiration reviendrait le lendemain, ou le jour d’après, ou le suivant peut-être. Mais les jours, les semaines et les mois avaient passé et l’inspiration n’était jamais revenue.
Ma descente aux enfers s’était décomposée en trois phases. La première, indispensable à toute bonne chute vertigineuse, avait été une ascension fulgurante : mon premier roman s’était vendu à deux mil ions d’exemplaires, me propulsant, à l’âge de vingt-huit ans, au rang d’écrivain à succès. C’était l’automne 2006 et en quelques semaines mon nom devint un nom : on me vit partout, à la télévision, dans les journaux, en couverture des magazines. Mon visage s’affichait sur d’immenses panneaux publicitaires dans les stations de métro. Les critiques les plus sévères des grands quotidiens de la côte Est étaient unanimes : le jeune Marcus Goldman allait devenir un très grand écrivain.
Un livre, un seul, et je me voyais désormais ouvrir les portes d’une nouvelle vie : cel e des jeunes vedettes millionnaires. Je déménageai de chez mes parents à Newark pour m’installer dans un appartement cossu du Vil age, je troquai ma Ford de troisième main pour une Range Rover noire flambant neuve aux vitres teintées, je me mis à fréquenter les restaurants huppés, je m’attachai les services d’un agent littéraire qui gérait mon emploi du temps et venait regarder le base-ball sur un écran géant dans mon nouveau chez-moi. Je louai, à deux pas de Central Park, un bureau dans lequel une secrétaire un peu amoureuse et prénommée Denise triait mon courrier, préparait mon café et classait mes documents importants.
Durant les six premiers mois qui suivirent la sortie du livre, je m’étais contenté de profiter de la douceur de ma nouvelle existence. Le matin, je passais à mon bureau pour parcourir les éventuels articles à mon sujet et lire les dizaines de lettres d’admirateurs que je recevais quotidiennement et que Denise rangeait ensuite dans des grands classeurs. Puis, content de moi-même et jugeant que j’avais assez travail é, je m’en al ais flâner dans les rues de Manhattan, où les passants bruissaient à mon passage. Je consacrais le reste de mes journées à profiter des nouveaux droits que la célébrité m’octroyait : droit de m’acheter tout ce dont j’avais envie, droit aux loges VIP
du Madison Square Garden pour suivre les matchs des Rangers, droit de marcher sur des tapis rouges avec des stars de la musique dont j’avais, plus jeune, acheté tous les disques, droit de sortir avec Lydia Gloor, l’actrice principale de la série télé du moment et que tout le monde s’arrachait. J’étais un écrivain célèbre; j’avais l’impression d’exercer le plus beau métier au monde. Et, certain que mon succès durerait toujours, je ne m’étais pas soucié des premiers avertissements de mon agent et de mon éditeur qui me pressaient de me remettre au travail et de commencer à écrire mon second roman.
C’est au cours des six mois suivants que je réalisai que le vent était en train de tourner : les lettres d’admirateurs se firent plus rares et dans les rues on m’abordait









