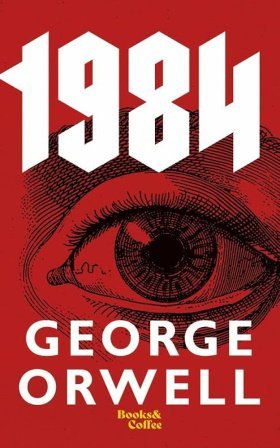Il avait parcouru plusieurs kilomètres sur des pavés, et son ulcère le démangeait. C’était la seconde fois en trois semaines qu’il avait manqué une soirée à la Maison Commune : un acte inconsidéré, puisque vous pouviez être certain que votre présence à la Maison était scrupuleusement vérifiée. En principe, un membre du Parti n’avait pas de temps libre, et n’était jamais seul, sauf au lit. Il était attendu qu’en dehors du travail, des repas ou du sommeil, il participât à toutes sortes d’activités collectives : faire quelque chose qui suggérait un attrait pour la solitude, même se promener seul, était toujours légèrement dangereux. Il y avait un mot pour ça en nouvelangue : êtrintime, désignant l’individualisme et l’excentricité. Mais ce soir-là, en sortant du Ministère, la douceur de l’air d’avril l’avait tenté.
Le ciel était d’un bleu plus profond qu’il ne l’avait jamais vu cette année, et soudain les longues et bruyantes soirées à la Maison, les jeux ennuyants et épuisants, les discours moralistes, la camaraderie grinçante lubrifiée au gin lui avaient paru insoutenables. D’un coup de tête, il s’était détourné de l’arrêt de bus et errait dans le labyrinthe londonien, d’abord vers le sud, puis vers l’est, et de nouveau vers le nord, se perdant dans des rues inconnues et ne se souciant guère de la direction qu’il empruntait.
79
« S’il y a de l’espoir, avait-il écrit dans son journal, c’est chez les prolos. » Les mots ne cessaient de lui revenir, assertion d’une vérité mystique et d’une absurdité palpable. Il était quelque part dans les vagues bidonvilles marron au nord et à l’est de ce qui avait été un jour la gare de Saint-Pancras. Il arpentait une rue pavée bordée de petites maisons à deux étages dont les portes défoncées donnaient directement sur le trottoir et ressemblaient curieusement à des trous de rats. Il y avait des flaques d’eau sale ici et là entre les pavés. À
travers des portes sombres et des étroites ruelles adjacentes allaient et venaient des nuées impressionnantes de passants — des filles en fleur au rouge à lèvres criards, des jeunes hommes les poursuivant, des femmes bouffies se dandinant pour vous montrer ce que deviendraient ces filles dans une dizaine d’années, et de vieilles créature courbées traînant leurs jambes arquées, et des enfants en haillons, pieds-nus, jouant dans les flaques et s’enfuyant aux cris furieux de leurs mères.
Un bon quart des fenêtres de la rue étaient brisées et recouvertes de planches. La plupart des personnes ne prêtèrent aucune attention à Winston ; seuls quelques-unes le regardèrent avec une sorte de curiosité prudente. Deux femmes monstrueuses, les bras rougeauds croisés par-dessus leurs tabliers, parlaient sur un perron. Winston surprit quelques bribes de conversation alors qu’il s’approchait.
« “Oui”, que j’lui dis à la bonne femme, “c’est ben gentil”, que j’lui dis. “Mais si z’auriez été à ma place, z’auriez fait la même chose que moi. C’est facile d’critiquer”, que j’lui dis, “mais z’avez pas mes problèmes.”
– Ah ça, répondit l’autre, c’est ben vrai, z’avez ben eu raison. »
Les voix stridentes s’interrompirent brusquement. Les femmes l’examinèrent dans un silence hostile quand il les dépassa. Ce n’était cependant pas exactement de l’hostilité ; plutôt une sorte de prudence, un raidissement momentané, comme au passage d’un animal inconnu.
La combinaison bleue du Parti ne devait pas être une vision habituelle dans une rue comme ça. Il était en effet imprudent d’être vu en un tel endroit, à moins d’avoir une tâche précise à y effectuer. Les patrouilles pouvaient vous arrêter si vous les croisiez. « Je peux voir tes papiers, camarade ? Qu’est-ce que tu fais là ? À quelle heure tu as quitté le 80
travail ? C’est ton chemin pour rentrer chez toi ? » et ainsi de suite.
Non pas qu’il y ait une règle contre le fait de rentrer chez soi par un chemin inhabituel : mais c’était assez pour attirer l’attention sur vous si la Police des Pensées l’apprenait.
Soudain, un tumulte gagna toute la rue. Il y eut des cris d’avertissement de tous côtés. Les passants se précipitèrent à travers les portes comme des lapins. Une jeune femme surgit d’une porte devant Winston, saisit un petit enfant jouant dans une flaque, l’enroba dans son tablier et regagna l’intérieur, dans un seul mouvement. Au même instant, un homme au costume noir frippé, qui avait émergé d’une ruelle, se rua vers Winston, pointant frénétiquement le ciel du doigt.
« Bouilloire ! hurla-t-il. Faîtes gaffe, chef ! Ça va péter ! Vite, au sol ! »
« Bouilloire » était le surnom que, pour une raison ou une autre, les prolos avaient donné aux missiles. Winston se jeta à terre. Les prolos avaient quasiment toujours raison quand ils vous donnaient ce genre d’avertissement. Ils semblaient posséder une sorte d’instinct qui les prévenait quelques secondes en avance qu’un missile approchait, alors même que les missiles étaient supposés voyager plus vite que le son. Winston recouvrit sa tête de ses avant-bras. Il y eut un rugissement qui sembla déchausser les pavés ; une pluie de petits objets s’abattit sur son dos. Quand il se releva, il vit qu’il était recouvert des fragments de verre d’une fenêtre proche.
Il reprit sa marche. La bombe avait démoli un groupe de maisons deux-cents mètres plus loin dans la rue. Un panache de fumée noire s’élevait dans le ciel, et, en-dessous, dans un nuage de poussières de plâtre, une foule se formait déjà autour des ruines. Il y avait un petit tas de plâtre sur la chaussée devant lui, et au milieu, il pouvait distinguer une traînée rouge-vif. Quand il s’en approcha, il s’aperçut que c’était une main humaine, coupée au poignet. À part le moignon ensanglanté, la main était complètement blanche et ressemblait à un moulage en plâtre.
D’un coup de pied, il l’envoya dans le caniveau, et, pour éviter la foule, emprunta une ruelle sur la droite. En trois ou quatre minutes, il fut hors de la zone touchée par la bombe, et les rues bourdonnaient 81
d’une vie sordide, comme si rien ne s’était produit. Il était presque vingt heures, et les débits de boisson que les prolos fréquentaient (ils les appelaient les « pubs ») étaient bondés de clients. Leurs sales portes battantes, qui s’ouvraient et se fermaient continuellement, laissaient échapper des effluves d’urine, de sciure et de bière aigre.
Dans l’angle de la façade d’une maison proéminente, trois hommes se serraient les uns contre les autres, celui du milieu tenant un journal plié que les deux autres examinaient par-dessus ses épaules. Avant même d’être assez près pour distinguer leurs expressions, Winston pouvait lire toute la concentration dans leur posture. Ils devaient certainement lire une nouvelle très importante. Il était à quelques pas d’eux quand le groupe se sépara soudainement, et deux des hommes entrèrent dans une violente altercation. Ils semblèrent même un instant prêts à en venir aux mains.
« Tu peux pas putain d’écouter c’que j’te dis ? Y a pas un numéro qui finit par sept qu’a gagné en quatorze mois !
– J’te dis que si !
– Moi j’te dis que non ! Chez moi j’ai tout d’noté sur un papier d’puis deux ans. Toutes les s’maines d’puis deux ans ! Alors j’te l’dis, y a pas un numéro qui finit par sept. . .
– Mais si, y a un sept qu’a gagné ! J’pourrais presque t’dire c’putain d’numéro. Y s’finissait par quatre - zéro - sept. C’était en février — deuxième semaine de février.
– Février d’ta grand-mère ! J’ai tout noté noir sur blanc. Et j’te l’dis, y a pas un numéro. . .
– Oh, fermez-là ! » les coupa le troisième homme.
Ils parlaient de la loterie. Winston regarda en arrière quand il les eut dépassés de trente mètres. Ils se disputaient toujours, les mines empourprées et passionnées. La loterie, avec ses prix hebdoma-daires mirobolants, était le seul événement public auquel les prolos accordaient une attention sérieuse. Pour des millions de prolos, la loterie était probablement leur principale, sinon leur seule, raison d’exister. C’était leur joie, leur folie, leur calmant, leur stimulation intellectuelle. Dès que cela concernait la loterie, même ceux pouvant à peine lire et écrire semblaient capables de calculs complexes et 82
d’impressionnants efforts de mémoire. Il y avait toute une clique d’hommes gagnant leur vie uniquement en vendant des systèmes, des prévisions et des amulettes porte-bonheur. Winston n’avait rien à voir avec le fonctionnement de la loterie, qui était gérée par le ministère de l’Abondance, mais il savait (comme tout le monde dans le Parti) que les prix étaient largement imaginaires. Seules quelques petites sommes étaient effectivement payées, les gagnant des gros lots étant des personnes inexistantes. En l’absence de toute communication entre les différentes régions d’Océania, ce n’était pas difficile à organiser.
Mais s’il y avait de l’espoir, c’était chez les prolos. Vous deviez vous y accrocher. En mots, cela semblait raisonnable : mais dès que vous regardiez les êtres humains vous croisant sur le trottoir, ça devenait un acte de foi. La rue dans laquelle il s’était engagé était en pente. Il eut l’impression de s’être déjà rendu dans ce quartier, et qu’un grand boulevard se trouvait non loin. Des éclats de voix lui parvinrent. La rue tourna brusquement et se termina sur un escalier descendant vers une allée enterrée où quelques étals vendaient des légumes fatigués. C’est alors que Winston se souvint d’où il était.
L’allée menait à la rue principale, et au prochain tournant, même pas cinq minutes plus loin, se trouvait le brocanteur où il avait acheté le carnet qui lui servait maintenant de journal. Et à une petite papeterie non loin il avait acheté son porte-plume et sa bouteille d’encre.
Il s’arrêta quelques instants en haut de l’escalier. De l’autre côté de l’allée se trouvait un petit pub miteux dont les fenêtres, qui paraissaient gelées, étaient en réalité couvertes de poussière. Un très vieil homme, voûté mais vif, dont la moustache blanche partait en avant comme les antennes d’une crevette, poussa la porte battante et entra. Alors qu’il l’observait, Winston eut une révélation : le vieillard, qui devait avoir au moins quatre-vingts ans, avait été adulte quand la Révolution avait eu lieu. Lui et quelques autres formaient le dernier lien avec le monde disparu du capitalisme. Même au sein du Parti ne subsistaient que peu de personnes dont les idées s’étaient construites avant la Révolution. Les anciennes génération avaient été quasiment toutes annihilées pendant les grandes purges des années cinquante 83
et soixante, et les rares survivants avaient depuis longtemps sombré, terrifiés, dans une totale reddition intellectuelle. Si quelqu’un d’encore vivant pouvait vous raconter honnêtement les conditions de vie du début du siècle, ça ne pouvait être qu’un prolo. Le passage qu’il avait recopié du manuel d’histoire revint à Winston, et il fut pris d’une pulsion soudaine. Il allait entrer dans le pub, il ferait connaissance avec le vieil homme et il le questionnerait. Il lui dirait : « Parle-moi de ton enfance. Comment c’était à l’époque ? Est-ce que c’était mieux ou pire que maintenant ? »
Hâtivement, avant de se laisser le temps de s’effrayer, il descendit les marches et traversa la petite rue. C’était pure folie, bien sûr.
Comme d’habitude, il n’y avait aucune règle empêchant de parler aux prolos et de fréquenter leurs pubs, mais c’était une action beaucoup trop inhabituelle pour passer inaperçue. Si les patrouilles se présentaient, il pourrait toujours prétendre à un malaise soudain, mais il n’était pas certain qu’ils le croiraient. Il poussa la porte, et une horrible odeur pourrie de bière aigre lui prit le nez. Quand il entra, le tumulte des voix baissa de moitié. Il pouvait sentir que dans son dos, tout le monde scrutait sa combinaison bleue. Une partie de fléchette à l’autre bout de la pièce s’interrompit pendant trente bonnes secondes. Le vieillard qu’il avait suivi se trouvait au comptoir, et se disputait avec le serveur, un jeune homme imposant, au nez crochu et aux énormes avant-bras. Un groupe se tenait autour, verre en main, regardant la scène.
« J’t’ai d’mandé poliment, non ? demanda le vieillard, vindicatif, redressant ses épaules. Tu m’dis qu’t’as pas une pinte dans ton putain d’rade ?
– Et c’est quoi une putain d’pinte ? répondit le serveur, se penchant en avant, la pointe des doigts sur le comptoir.
– R’gardez-le ! Y s’dit serveur et y sait même pas c’qu’est une pinte ! Bah une pinte c’est la moitié d’un quart, et y a quatre quarts dans un gallon ! J’dois aussi t’apprendre l’alphabet ?
– Jamais entendu parler d’ça, dit brièvement le serveur. On sert qu’des litres ou des d’mi-litres. Y a les verres sur l’étagère en face de toi.
84
– J’veux une pinte, persista le vieillard. T’aurais pu facilement m’sortir une pinte. On avait pas ces putains d’litres quand j’étais jeune.
– Quand t’étais jeune on vivait tous dans les arbres », répliqua le serveur, en regardant les autres clients.