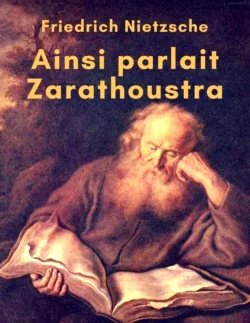Mes talons se cambraient, mes orteils écoutaient pour te comprendre : le danseur ne porte-t-il pas son oreille – dans ses orteils !
C’est vers toi que j’ai sauté : alors tu t’es reculée devant mon élan ; et c’est vers moi que sifflaient les languettes de tes cheveux fuyants et volants !
D’un bond je me suis reculé de toi et de tes serpents : tu te dressais déjà à demi détournée, les yeux pleins de désirs.
Avec des regards louches – tu m’enseignes des voies détournées ; sur des voies détournées mon pied apprend – des ruses !
Je te crains quand tu es près de moi, je t’aime quand tu es loin de moi ; ta fuite m’attire, tes recherches m’arrêtent : – je souffre, mais, pour toi, que ne souffrirais-je pas volontiers !
Toi, dont la froideur allume, dont la haine séduit, dont la fuite attache, dont les moqueries – émeuvent :
– qui ne te haïrait pas, grande lieuse, enveloppeuse, séduisante, chercheuse qui trouve !
Qui ne t’aimerait pas, innocente, impatiente, hâtive pécheresse aux veux d’enfant !
Où m’entraînes-tu maintenant, enfant modèle, enfant mutin ? Et te voilà qui me fuis de
nouveau, doux étourdi, jeune ingrat !
Je te suis en dansant, même sur une piste incertaine. Où es-tu ? Donne-moi la main ! Ou
bien un doigt seulement !
Il y a là des cavernes et des fourrés : nous allons nous égarer ! – Halte ! Arrête-toi ! Ne vois-tu pas voltiger des hiboux et des chauves-souris ?
Toi, hibou que tu es ! Chauve-souris ! Tu veux me narguer ? Où sommes-nous ? C’est
des chiens que tu as appris à hurler et à glapir.
Aimablement tu claquais devant moi de tes petites dents blanches, tes yeux méchants pétillent vers moi à travers ta petite crinière bouclée !
Quelle danse par monts et par vaux ! je suis le chasseur : – veux-tu être mon chien ou
mon chamois ?
À côté de moi maintenant ! Et plus vite que cela, méchante sauteuse ! Maintenant en haut ! Et de l’autre côté ! – Malheur à moi ! En sautant je suis tombé moi-même !
Ah ! Regarde comme je suis étendu ! regarde, pétulante, comme j’implore ta grâce !
J’aimerais bien à suivre avec toi – des sentiers plus agréables !
– les sentiers de l’amour, à travers de silencieux buissons multicolores ! Ou bien là-bas,
ceux qui longent le lac : des poissons dorés y nagent et y dansent !
Tu es fatiguée maintenant ? Il y a là-bas des brebis et des couchers de soleil : n’est-il
pas beau de dormir quand les bergers jouent de la flûte ?
Tu es si fatiguée ? Je vais t’y porter, laisse seulement flotter tes bras ! As-tu peut-être soif ? – j’aurais bien quelque chose, mais ta bouche n’en veut pas !
Ô ce maudit serpent, cette sorcière glissante, brusque et agile ! Où t’es-tu fourrée ? Mais sur mon visage je sens deux marques de ta main, deux taches rouges !
Je suis vraiment fatigué d’être toujours ton berger moutonnier ! Sorcière ! j’ai chanté pour toi jusqu’à présent, maintenant pour moi tu dois – crier !
Tu dois danser et crier au rythme de mon fouet ! Je n’ai pourtant pas oublié le fouet ? –
Non ! » –
2.
Voilà ce que me répondit alors la vie, en se bouchant ses délicates oreilles :
« Ô Zarathoustra ! Ne claque donc pas si épouvantablement de ton fouet ! Tu le sais bien : le bruit assassine les pensées, – et voilà que me viennent de si tendres pensées.
Nous sommes tous les deux de vrais propres à rien, de vrais fainéants. C’est par delà le
bien et mal que nous avons trouvé notre île et notre verte prairie – nous les avons trouvées tout seuls à nous deux ! C’est pourquoi il faut que nous nous aimions l’un l’autre !
Et si même nous ne nous aimons pas du fond du cœur, – faut-il donc s’en vouloir, quand
on ne s’aime pas du fond du cœur ?
Et que je t’aime, que je t’aime souvent de trop, tu sais cela : et la raison en est que je
suis jaloux de ta sagesse. Ah ! cette vieille folle sagesse !
Si ta sagesse se sauvait une fois de toi, hélas ! vite mon amour, lui aussi, se sauverait de toi. » –