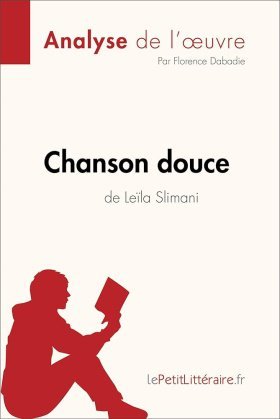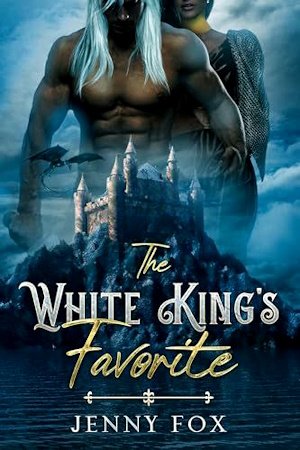entendu des cris pareils. Ce sont des cris qu’on pousse à la guerre, dans les tranchées, dans d’autres mondes, sur d’autres continents.
Ce ne sont pas des cris d’ici. Ça a duré au moins dix minutes, ce cri, poussé presque d’une traite, sans sou e et sans mots. Ce cri qui devenait rauque, qui s’emplissait de sang, de morve, de rage. « Un docteur », c’est tout ce qu’elle a ni par articuler. Elle n’a pas appelé à l’aide, elle n’a pas dit « Au secours » mais elle a répété, dans les rares moments où elle redevenait consciente, « Un docteur ».
Un mois avant le drame, Mme Grinberg avait rencontré Louise dans la rue. La nounou avait l’air soucieuse et elle avait ni par parler de ses problèmes d’argent. De son propriétaire qui la harcelait, des dettes qu’elle avait accumulées, de son compte en banque toujours dans le rouge. Elle avait parlé comme un ballon se vide de son air, de plus en plus vite.
Mme Grinberg avait fait semblant de ne pas comprendre. Elle avait baissé le menton, elle avait dit « les temps sont durs pour tout le monde ». Et puis Louise lui avait attrapé le bras. « Je ne mendie pas. Je peux travailler, le soir ou tôt le matin. Quand les enfants dorment. Je peux faire le ménage, du repassage, tout ce que vous voudrez. » Si elle ne lui avait pas serré si fort le poignet, si elle n’avait pas planté ses yeux noirs dans les siens, comme une injure ou une menace, Rose Grinberg aurait peut-être accepté. Et, quoi qu’en disent les policiers, elle aurait tout changé.
L’avion a eu beaucoup de retard et ils atterrissent à Paris en début de soirée. Louise fait aux enfants des adieux solennels. Elle les embrasse longtemps, les tient serrés dans ses bras. « À lundi, oui, à lundi. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit », dit-elle à Myriam et à Paul qui s’engou rent dans l’ascenseur pour rejoindre le parking de l’aéroport.
Louise marche vers le RER. La rame est déserte. Elle s’assoit contre une vitre et elle maudit le paysage, les quais où traînent des bandes de jeunes, les immeubles pelés, les balcons, le visage hostile des agents de sécurité. Elle ferme les yeux et convoque des souvenirs de plages grecques, de couchers de soleil, de dîners face à la mer. Elle invoque ces souvenirs comme les mystiques en appellent aux miracles. Quand elle ouvre les portes de son studio, ses mains se mettent à trembler. Elle a envie de déchirer la housse du canapé, de donner un coup de poing dans la vitre. Un magma informe, une douleur lui brûlent les entrailles et elle a du mal à se retenir de hurler.
Le samedi, elle reste au lit jusqu’à 10 heures. Couchée sur le canapé, les mains croisées sur sa poitrine, Louise regarde la poussière qui s’est accumulée sur la suspension verte. Elle n’aurait jamais choisi quelque chose d’aussi laid. Elle a loué l’appartement meublé et
n’a rien changé à la décoration. Il fallait trouver un logement après la mort de Jacques, son mari, et son expulsion de la maison. Après des semaines d’errance, il lui fallait un nid. Ce studio, à Créteil, elle l’a trouvé grâce à une in rmière d’Henri-Mondor, qui s’était prise d’a ection pour elle. La jeune femme lui a assuré que le propriétaire demandait peu de garanties et qu’il acceptait les paiements en liquide Louise se lève. Elle pousse une chaise, la place juste en dessous de la suspension et attrape un torchon. Elle se met à astiquer la lampe et l’agrippe avec tant de force qu’elle manque de l’arracher du plafond. Elle est sur la pointe des pieds et elle secoue la poussière qui lui tombe dans les cheveux, en gros ocons gris. À 11 heures, elle a tout nettoyé. Elle a refait les vitres, l’intérieur et l’extérieur, et elle a même passé une éponge savonneuse sur les volets. Ses chaussures sont disposées en ligne le long du mur, brillantes et ridicules.
Ils vont peut-être l’appeler. Le samedi, elle le sait, ils déjeunent parfois au restaurant. C’est Mila qui le lui a raconté. Ils se rendent dans une brasserie où la petite lle a le droit de commander tout ce qu’elle veut et où Adam goûte sur le bout d’une cuillère un soupçon de moutarde ou de citron, sous l’œil attendri de ses parents. Louise aimerait ça. Dans une brasserie bondée, cernée par le bruit des assiettes qui s’entrechoquent et le hurlement des serveurs, elle aurait moins peur du silence. Elle s’assiérait entre Mila et son frère et elle rajusterait la grande serviette blanche sur les genoux de la petite lle.
Elle donnerait à manger à Adam, cuillère après cuillère. Elle écouterait Paul et Myriam parler, tout irait trop vite, elle se sentirait bien.
Elle a mis sa robe bleue, celle qui lui arrive juste au-dessus des chevilles et qui se ferme, sur le devant, par une rangée de petites
perles bleues. Elle voulait être prête, au cas où ils auraient besoin d’elle. Au cas où il faudrait les rejoindre quelque part, à toute vitesse, eux qui sans doute ont oublié à quel point elle vit loin et le temps qu’elle met, chaque jour, à revenir vers eux. Assise dans sa cuisine, elle pianote du bout des ongles sur la table en formica.
L’heure du déjeuner passe. Les nuages ont glissé devant les vitres propres, le ciel s’est assombri. Le vent a sou é très fort dans les platanes et la pluie se met à tomber. Louise s’agite. Ils ne l’appellent pas.
Il est trop tard maintenant pour sortir. Elle pourrait aller acheter du pain ou respirer un peu d’air. Elle pourrait juste marcher. Mais elle n’a rien à faire dans ces rues dépeuplées. Le seul café du quartier est un repaire d’ivrognes et à 15 heures à peine, il arrive que des hommes se mettent à se battre contre les grilles du jardin désert. Elle aurait dû se décider avant, s’engou rer dans le métro, errer dans Paris, au milieu des gens qui font leurs achats pour la rentrée. Elle se serait perdue dans la foule et elle aurait suivi des femmes, belles et pressées, devant les grands magasins. Elle aurait traîné près de la Madeleine, frôlant les petites tables où les gens prennent un café. Elle aurait dit « Pardon » à ceux qui la bousculent.
Paris est à ses yeux une vitrine géante. Elle aime surtout se promener dans le quartier de l’Opéra, descendre la rue Royale et prendre la rue Saint-Honoré. Elle marche lentement, observe les passantes et les vitrines. Elle veut tout. Les bottes en daim, les vestes en peau retournée, les sacs en python, les robes portefeuilles, les caracos surpiqués de dentelles. Elle veut les chemises en soie, les cardigans roses en cachemire, les collants sans marque, les vestes d’o cier. Elle s’imagine alors une vie où elle aurait les moyens de
tout avoir. Où elle montrerait du doigt à une vendeuse mielleuse les articles qui lui plairaient.
Dimanche arrive, dans la continuité de l’ennui et de l’angoisse.
Dimanche sombre et grave au fond du canapé-lit. Elle s’est endormie dans sa robe bleue dont le tissu synthétique, a reusement froissé, l’a fait transpirer. Plusieurs fois dans la nuit, elle a ouvert les yeux, sans savoir si une heure était passée ou un mois. Si elle dormait chez Myriam et Paul ou à côté de Jacques, dans la maison de Bobigny.
Elle refermait les yeux et plongeait à nouveau dans un sommeil brutal et délirant.
Louise, décidément, déteste les week-ends. Quand elles vivaient encore ensemble, Stéphanie se plaignait de ne rien faire le dimanche, de n’avoir pas droit aux activités que Louise organisait pour les autres enfants. Dès qu’elle a pu, elle a fui la maison. Le vendredi, elle sortait toute la nuit avec des adolescents du quartier. Elle rentrait au matin, la mine blafarde, les yeux rouges et cernés. A amée. Elle traversait le petit salon, la tête basse, et elle se jetait sur le frigidaire.
Elle mangeait, adossée à la porte du frigo, sans même s’asseoir, enfonçant ses doigts dans les boîtes que Louise avait préparées pour les déjeuners de Jacques. Une fois, elle s’était teint les cheveux en rouge. Elle s’était fait percer le nez. Elle s’est mise à disparaître, des week-ends entiers. Et puis un jour, elle n’est pas revenue. Plus rien ne la retenait dans la maison de Bobigny. Ni le lycée, qu’elle avait quitté depuis longtemps. Ni Louise.
Sa mère, bien sûr, a déclaré sa disparition. « Une fugue, à cet âge, c’est courant. Attendez un peu et elle reviendra. » On ne lui a rien dit de plus. Elle ne l’a pas cherchée. Plus tard, elle a appris par des
voisins que Stéphanie était dans le Sud, qu’elle était amoureuse.
Qu’elle bougeait beaucoup. Les voisins n’en sont pas revenus que Louise ne demande pas de détails, qu’elle ne pose pas de questions, qu’elle ne leur fasse pas répéter les maigres informations dont ils disposaient.
Stéphanie avait disparu. Toute sa vie, elle avait eu l’impression de gêner. Sa présence dérangeait Jacques, ses rires réveillaient les enfants que Louise gardait. Ses grosses cuisses, son pro l lourd s’écrasaient contre le mur, dans le couloir étroit, pour laisser passer les autres. Elle craignait de bloquer le passage, de se faire bousculer, d’encombrer une chaise dont quelqu’un d’autre voudrait. Quand elle parlait, elle s’exprimait mal. Elle riait et on s’en o ensait, si innocent que fût son rire. Elle avait ni par développer un don pour l’invisible et logiquement, sans éclats, sans prévenir, comme si elle y était évidemment destinée, elle avait disparu.
Lundi matin, Louise sort de chez elle avant que le jour se lève.
Elle marche vers le RER, fait le changement à Auber, attend sur le quai, remonte la rue Lafayette puis prend la rue d’Hauteville. Louise est un soldat. Elle avance, coûte que coûte, comme une bête, comme un chien à qui de méchants enfants auraient brisé les pattes.
Septembre est chaud et lumineux. Le mercredi, après l’école, Louise bouscule les humeurs casanières des enfants et les emmène jouer au parc ou observer les poissons à l’aquarium. Ils ont fait de la barque sur le lac du bois de Boulogne et Louise a raconté à Mila que les algues qui ottaient à la surface étaient en réalité les cheveux d’une sorcière déchue et vengeresse. À la n du mois, il fait si doux que Louise, joyeuse, décide de les emmener au jardin d’acclimatation.
Devant la station de métro, un vieux Maghrébin propose à Louise de l’aider à descendre les escaliers. Elle le remercie et se saisit à bout de bras de la poussette dans laquelle est encore assis Adam.
Le vieil homme la suit. Il lui demande quel âge ont ses enfants. Elle s’apprête à lui dire que ce ne sont pas les siens. Mais il s’est déjà penché à hauteur des petits. « Ils sont très beaux. »
Le métro est ce que les enfants préfèrent. Si Louise ne les retenait pas, ils courraient sur le quai, ils se jetteraient dans la rame en écrasant les pieds des passagers, tout ça pour s’asseoir contre la vitre, la langue pendante, les yeux grands ouverts. Ils se mettent debout et Adam imite sa sœur qui s’accroche à la barre et fait semblant de conduire le train.
Dans le jardin, la nounou court avec eux. Ils rient, elle les gâte, leur o re des glaces et des ballons. Elle les prend en photo, couchés sur un tapis de feuilles mortes, jaune vif ou rouge sang. Mila demande pourquoi certains arbres ont pris cette teinte dorée, lumineuse, tandis que d’autres, les mêmes, plantés à côté ou en face, semblent pourrir, passant directement du vert au marron foncé.
Louise est incapable de se l’expliquer. « On demandera à ta maman », dit-elle.
Dans les manèges, ils hurlent de terreur et de joie. Louise a le vertige et elle tient Adam bien fort sur ses genoux quand le train s’enfonce dans les tunnels sombres et dévale des pentes à toute vitesse. Dans le ciel un ballon s’envole, Mickey est devenu un vaisseau spatial.
Ils s’installent sur l’herbe pour pique-niquer et Mila se moque de Louise qui a peur des grands paons, à quelques mètres d’eux. La nounou a emporté une vieille couverture en laine que Myriam avait roulée en boule sous son lit et que Louise a nettoyée et reprisée. Ils s’endorment tous les trois sur l’herbe. Louise se réveille, Adam collé contre elle. Elle a froid, les enfants ont dû tirer la couverture. Elle se retourne et ne voit pas Mila. Elle l’appelle. Elle se met à hurler. Les gens se retournent. On lui demande : « Tout va bien, madame ? Vous avez besoin d’aide ? » Elle ne répond pas. « Mila, Mila », hurle-t-elle en courant, Adam dans ses bras. Elle fait le tour des manèges, court devant le stand de carabine. Les larmes lui montent aux yeux, elle a envie de secouer les passants, de pousser les inconnus qui se pressent là, tenant bien en main leurs enfants. Elle retourne vers la fermette.
Sa mâchoire tremble tellement qu’elle ne peut même plus appeler la llette. Son crâne lui fait atrocement mal et elle sent que ses genoux se mettent à ancher. Dans un instant, elle tombera par terre, incapable de faire un geste, muette, totalement démunie.
Puis elle l’aperçoit, au bout d’une allée. Mila mange une glace sur un banc, une femme penchée vers elle. Louise se jette sur l’enfant.
« Mila ! Mais tu es complètement folle ! Qu’est-ce qui t’a pris de partir comme ça ? » L’inconnue, une femme d’une soixantaine d’années, serre la petite lle contre elle. « C’est scandaleux. Qu’est-ce que vous faisiez ? Comment a-t-elle pu se retrouver toute seule ? Je pourrais très bien demander le numéro de ses parents à la petite. Je ne suis pas sûre qu’ils apprécieraient. »
Mais Mila échappe à l’étreinte de l’inconnue. Elle la repousse et lui lance un regard méchant, avant de se jeter contre les jambes de Louise. La nounou se penche vers elle et la soulève. Louise embrasse son cou glacé, elle lui caresse les cheveux. Elle regarde le visage blême de l’enfant et s’excuse de sa négligence. « Ma petite, mon ange, mon chaton. » Elle la cajole, la couvre de baisers, la tient serrée contre sa poitrine.
En voyant l’enfant se lover dans les bras de la petite femme blonde, la vieille se calme. Elle ne sait plus quoi dire. Elle les observe en remuant la tête d’un air de reproche. Elle espérait sans doute provoquer un scandale. Cela l’aurait distraite. Elle aurait eu quelque chose à raconter si la nounou s’était mise en colère, s’il avait fallu appeler les parents, si des menaces avaient été proférées puis mises à exécution. L’inconnue nit par se lever de ce banc, et elle part en disant : « Bon, la prochaine fois, vous ferez attention. »