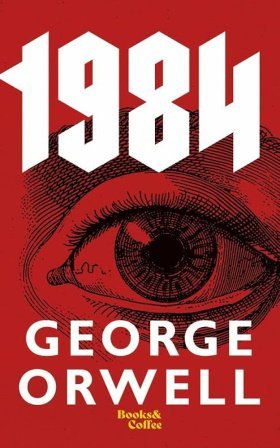Dissimuler ses sentiments, contrôler ses expressions, faire comme tous les autres, c’était un réflexe inné. Mais pendant quelques secondes, il avait été possible que l’expression dans ses yeux l’eût trahi. Et c’était exactement à cet instant que s’était produit l’événement remarquable
— si, toutefois, il s’était vraiment produit.
Ses yeux se tournèrent brièvement vers O’Brien. Ce dernier s’était levé. Il avait enlevé ses lunettes et était en train de les remettre avec son geste caractéristique. Le temps d’une fraction de secondes, leurs regards se croisèrent, et Winston sut — oui, il sut ! — qu’O’Brien pensait la même chose que lui. Un message indiscutable était passé.
Comme si leurs deux esprits s’étaient ouverts, et leurs pensées s’échangeaient à travers leurs yeux. « Je suis avec toi », semblait lui dire O’Brien. « Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais tout de ton mépris, de ta haine, de ton dégoût. Mais ne t’inquiète pas, je suis de ton côté ! » Puis l’éclair d’intelligence s’éteignit, et le visage d’O’Brien redevint aussi insondable que celui des autres.
C’était tout, et déjà il doutait que cela se fût vraiment passé. De tels incidents n’avaient jamais de suites. Ils ne faisaient qu’entretenir en lui la croyance, ou l’espoir, que d’autres que lui étaient aussi les ennemis du Parti. Les rumeurs de grandes conspirations clandestines étaient peut-être vraies après tout — peut-être que la Fraternité existait réellement ! Il était impossible, malgré toutes les arrestations, les confessions et les exécutions, d’être sûr que la Fraternité n’était pas simplement un mythe. Certains jours il y croyait, d’autres non. Il 18
n’y avait aucune preuve, juste des traces fugaces qui pouvaient tout et rien dire : des fragments de conversations entendues par hasard, de vagues graffitis sur les murs des toilettes, et même, un jour, quand deux étrangers s’étaient rencontrés, un léger mouvement de la main qui aurait pu ressembler à un signe de reconnaissance. Ce n’était que des hypothèses : il avait très certainement imaginé tout ceci. Il avait regagné sa cabine sans un autre regard pour O’Brien. L’idée de poursuivre leur contact momentané lui effleura à peine l’esprit. Cela aurait été incroyablement dangereux, même s’il avait su comment s’y prendre. Pendant une ou deux secondes, ils avaient échangé un regard équivoque, fin de l’histoire. Mais c’était déjà un événement extraordinaire qui brisait la solitude forcée dans laquelle chacun devait vivre.
Winston se redressa sur sa chaise. Il laissa s’échapper un rot. Le gin remontait de son estomac.
Ses yeux se concentrèrent sur la page. Il découvrit que pendant sa réflexion, il avait également écrit, de manière complètement automatique. Et ce n’était plus la maladroite et laborieuse écriture d’avant.
La plume avait voluptueusement glissé sur le papier, marquant de larges lettres :
MORT À TONTON
MORT À TONTON
MORT À TONTON
MORT À TONTON
MORT À TONTON
Encore et encore, remplissant la moitié de la page.
Il ne put s’empêcher de ressentir un frisson de panique. C’était absurde, puisque écrire ces mots n’était pas plus dangereux que le fait de tenir un journal ; mais pendant un instant il contempla l’idée de déchirer la page et d’abandonner tout le projet.
Cependant, il ne le fit pas. Il savait que c’était inutile. Qu’il écrivît
« MORT À TONTON » ou qu’il s’abstînt ne changeait rien. Qu’il continuât le journal ou qu’il l’arrêtât ne changeait rien. La Police des Pensées l’attraperait dans tous les cas. Il avait commis — et aurait 19
commis, même sans rien avoir écrit — le crime essentiel, celui qui contenait tous les autres. Ils l’appelaient le crimepense. Le crimepense ne pouvait pas être dissimulé pour toujours. Vous pouviez le cacher pour quelque temps, plusieurs années même, mais tôt ou tard, ils vous attraperaient.
C’était toujours la nuit — les arrestations avaient toujours lieu pendant la nuit. Le réveil en sursaut, la main brutale qui vous se-couait l’épaule, les lumières qui vous aveuglaient, la sinistre ronde de visages autour du lit. Dans la plupart des cas, il n’y avait ni procès, ni mention de l’arrestation. Les personnes disparaissaient tout simplement, toujours la nuit. Votre nom était retiré des registres, chaque trace de chacune de vos actions était effacée, votre existence était reniée puis oubliée. Vous étiez aboli, annihilé : vaporisé, disait-on.
Pendant un instant, il fut pris d’une sorte d’hystérie. Il commença à griffonner nerveusement :
ils me tueront je m’en fous ils me tireront dans le dosje m’en fous mort à Tonton ils vous tirent toujours dansle dos je m’en fous mort à Tonton —
Il recula sur sa chaise, légèrement honteux, et posa le porte-plume.
Il sursauta violemment : on frappait à la porte.
Déjà ! Il s’immobilisa sur sa chaise, dans l’espoir vain que qui que ce fût, ils s’en iraient après un seul essai. Mais non, on frappa à nouveau. Le pire serait de repousser le moment fatidique. Son cœur battait la chamade, mais son visage, par habitude, était probablement de marbre. Il se leva et marcha lourdement vers la porte.
20
C h a p i t r e I I
En posant sa main sur la poignée de la porte, Winston remarqua qu’il avait laissé le carnet ouvert sur la table. « MORT À TONTON »
recouvrait les pages, en lettres assez grandes pour être lisibles à travers la pièce. C’était incroyablement stupide de sa part. Cependant, réalisa-t-il, même dans sa panique, il n’avait pas voulu tacher le papier crémeux en fermant le carnet alors que l’encre n’était pas encore sèche.
Il inspira profondément et ouvrit la porte. Une vague d’un intense soulagement l’envahit. Une femme grisâtre et décrépie, aux cheveux épars et au visage buriné, se tenait dehors.
« Oh, camarade, commença-t-elle dans un gémissement lugubre, je savais que je t’avais entendu rentrer. Tu penses que tu pourrais passer et jeter un œil à notre évier ? Il est bouché et. . . »
C’était Mme Parsons, la femme d’un voisin au même étage. (« Ma-dame » était un mot réprouvé par le Parti — vous étiez censé appeler tout le monde « camarade » — mais avec certaines femmes, vous l’uti-lisiez instinctivement.) C’était une femme d’une trentaine d’années, mais elle en paraissait bien plus. On avait l’impression qu’il y avait de la poussière incrustée dans les rides de son visage. Winston la suivit dans le couloir. Ces bricolages amateurs étaient une irritation quasi-quotidienne. Les appartements de la Résidence de la Victoire, construite dans les années 1930, étaient vétustes et tombaient en morceaux. Le plâtre des plafonds et des murs s’effritait, les tuyaux éclataient à la moindre gelée, le toit fuyait dès qu’il neigeait, le chauf-fage ne tournait qu’à mi-régime, quand il n’était tout simplement pas coupé pour faire des économies. Les réparations, sauf celles que vous 21
pouviez faire vous-même, devaient être approuvées par des comités qui pouvaient statuer sur le remplacement d’une fenêtre pendant deux ans.
« Bien sûr c’est juste parce que Tom est pas là », se justifia vaguement Mme Parsons.
L’appartement des Parsons était plus grand que celui de Winston, et miteux d’une autre façon. Tout avait l’air cabossé et piétiné, comme si l’endroit venait d’être visité par des animaux sauvages. Des restes de jeux — des crosses de hockey, des gants de boxe, un ballon éclaté, un short retourné — jonchaient le sol, et des piles de vaisselle sale et des cahiers écornés recouvraient la table. Aux murs pendaient des bannières écarlates de la Ligue de la Jeunesse et des Infiltrés et une affiche grandeur nature de Tonton. À l’odeur habituelle de chou bouilli, commune à tout l’immeuble, s’ajoutaient de vifs relents de sueur qui — vous les reconnaissiez à la première inspiration, sans vraiment savoir pourquoi — provenaient d’une personne qui n’était pas là. Dans la pièce d’à-côté, quelqu’un essayait de suivre le rythme de la musique militaire qui s’échappait toujours du télécran avec un peigne et un rouleau de papier toilette.
« C’est les enfants, dit Mme Parsons, jetant un regard craintif vers la porte. Ils sont pas sortis aujourd’hui. Du coup. . . »
Elle ne finissait jamais ses phrases. L’évier débordait presque d’un liquide verdâtre qui empestait plus que jamais le chou. Winston s’agenouilla et inspecta le siphon. Il détestait se servir de ses mains, et il détestait s’agenouiller, ce qui pouvait réveiller sa toux. Mme Parsons le regardait, inerte.
« Oh, si Tom avait été à la maison, il aurait tout réparé vite fait, dit-elle. Il adore tout ça, il est si doué de ses mains. »
Parsons était un collègue de Winston au ministère de la Vérité.
Obèse mais vif, c’était un homme d’une stupidité déconcertante, un amas d’enthousiasmes imbéciles — une de ces bêtes de somme aveuglées dont dépendait, plus encore que de la Police des Pensées, la stabilité du Parti. À trente-cinq ans, il avait été expulsé contre son gré de la Ligue de la Jeunesse, et, avant de l’intégrer, il avait réussi à rester aux Infiltrés un an après l’âge autorisé. Au Ministère, il occupait un 22