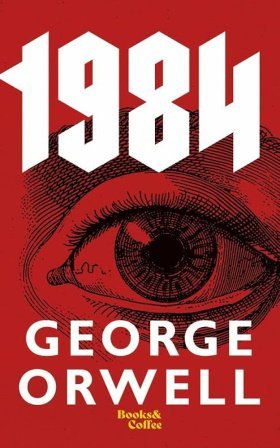entrepôts où les documents corrigés étaient stockés, et les fourneaux cachés où étaient détruites les versions originales. Et quelque part, anonymes, il y avait les cerveaux dirigeants qui coordonnaient toute l’entreprise et décidaient des politiques qui rendaient nécessaire que tel fragment du passé dût être préservé, tel autre falsifié, et tel autre effacé de toute existence.
Et le département des Archives, après tout, n’était lui-même qu’une simple branche du ministère de la Vérité, dont la principale mission n’était pas de reconstruire le passé mais de fournir aux citoyens d’Océania des journaux, des films, des manuels, des programmes de télécran, des pièces de théâtre, des romans — contenant tous les types d’informations, d’enseignements ou de divertissements imaginables, de la statue au slogan, du poème lyrique au traité de biologie, et du manuel d’orthographe pour enfant à un dictionnaire de nouvelangue. Et le Ministère devait non seulement répondre aux divers besoins du Parti, mais aussi répéter la même opération au niveau inférieur pour le prolétariat. Il y avait toute une chaîne parallèle de départements s’occupant de la littérature, de la musique, du théâtre et du divertissement prolétarien. Là étaient produits tous les journaux de caniveau qui ne contenaient rien d’autre que du sport, du fait-divers et de l’astrologie, les nouvelles sensationnalistes à cinq cents, les films suintant de sexe, et les chansons sentimentalistes qui étaient entièrement composées mécaniquement sur un kaléidoscope spécial appelé un versificateur. Il y avait même une sous-section entière — la Pornosec en nouvelangue — dédiée à la production de la pornographie la plus abjecte, qui était expédiée dans des paquets scellés et qu’aucun membre du Parti, autre que ceux ayant travaillé dessus, n’avait le droit de regarder.
Trois messages avaient jailli du tube pneumatique pendant que Winston travaillait ; mais il s’agissait de simple tâches, et il les eut accomplies avant que les Deux Minutes de Haine ne l’interrompissent.
La Haine finie, il regagna sa cabine, prit le dictionnaire de nouvelangue sur l’étagère, poussa le parlécrit sur le côté, nettoya ses lunettes et s’attela à sa principale mission de la matinée.
Le plus grand plaisir de Winston était son travail. La plupart du 42
temps ce n’était qu’une routine fastidieuse, mais il y avait quelquefois des tâches si difficiles et complexes que vous pouviez vous y perdre comme dans les profondeurs d’un problème mathématique — de délicats actes de falsification où vous n’aviez d’autre repère que votre connaissance des principes de l’Angsoc et votre appréciation de ce que le Parti attendait de vous. Winston était doué à ça. On lui confiait même de temps en temps la rectification des articles principaux du Times, qui étaient intégralement écrits en nouvelangue. Il déroula le message qu’il avait mis de côté plus tôt. Il disait : times 3.12.83 rapportant ordrejour tt doubleplusnon-bon ref nonpersonnes récrire totalment supcontrole préar-chivant
En vieulangue (ou langue standard), cela donnerait : Le reportage sur l’Ordre du Jour de Tonton dans le Times du 3 décembre 1983 est extrêmement insatisfaisant et fait référence à des personnes inexistantes. Réécrivez-le entièrement et faites contrôler votre brouillon à vos supérieurs avant de l’archiver.
Winston parcourut l’article incriminé. Apparemment, l’Ordre du Jour de Tonton avait été principalement dédié à l’éloge d’une organisation nommée CCFF, qui fournissait en cigarettes et autres commodités les marins des Forteresses Flottantes. Un certain camarade Withers, membre éminent du Parti Intérieur, avait été sélectionné pour une mention spéciale et gratifié d’une décoration, l’Ordre du Mérite Apparent, seconde classe.
Trois mois plus tard, les CCFF avaient soudainement été dissoutes, sans raison. On pouvait supposer que Withers et ses associés étaient maintenant en disgrâce, mais il n’y en avait eu aucune mention dans la presse ou au télécran. Ce n’était pas une surprise, puisqu’il était rare qu’un criminel politique soit jugé ou même publiquement récusé.
Les grandes purges impliquant des milliers de personnes, avec les procès publics des traîtres et des crimepenseurs faisant l’abjecte confession de leurs crimes et étant ensuite exécutés, étaient de grands 43
moments de spectacle qui avaient à peine lieu une fois par an. La plupart du temps, les personnes qui s’étaient attiré les foudres du Parti disparaissaient simplement et on n’en entendait plus jamais parler. Personne n’avait la moindre idée de ce qu’il advenait d’elles.
Dans certains cas elles n’étaient peut-être même pas morte. Winston avait personnellement connu une trentaine de personnes qui avaient disparu à un moment ou à un autre.
Winston se frotta lentement le nez avec un trombone. Dans la cabine d’en face, le camarade Tillotson était toujours soupçonneu-sement recroquevillé sur son parlécrit. Il releva la tête un moment : à nouveau, un coup d’œil hostile. Winston se demanda si le camarade Tillotson travaillait sur le même message que lui. C’était tout à fait possible. Une tâche si complexe ne pouvait pas être confiée à une seule personne : et au contraire, la confier à un comité serait admettre ouvertement qu’un acte de falsification avait lieu. Très probablement, une dizaine de personnes travaillaient en même temps sur des versions concurrentes de ce que Tonton avait réellement dit. Et un des cerveaux du Parti Intérieur choisirait telle ou telle version, la corrigerait et lancerait le complexe processus de référencement croisé qui serait nécessaire, et le mensonge choisi passerait dans les archives permanentes et deviendrait réalité.
Winston ne savait pas pourquoi Withers était tombé en disgrâce.
Peut-être pour corruption ou incompétence. Peut-être que Tonton s’était tout simplement débarrassé d’un subalterne un peu trop populaire. Peut-être que Withers ou un de ses proches avaient été suspectés de tendances hérétiques. Ou peut-être — c’était le plus probable — était-ce arrivé parce que les purges et les vaporisations étaient un élément nécessaire de la mécanique de gouvernement. Le seul indice résidait dans les mots « ref nonpersonnes », qui indiquait que Withers était déjà mort. Vous ne pouviez pas nécessairement le supposer quand une personne était arrêtée. Quelquefois elle était relâchée et autorisée à rester en liberté pour une année ou deux avant d’être exécutée. Très rarement, une personne que vous pensiez morte depuis bien longtemps faisait une apparition fantomatique à un procès public où elle incriminait des centaines d’autres par son 44
témoignage avant de disparaître, cette fois pour toujours. Withers, toutefois, était déjà une nonpersonne. Il n’existait pas : il n’avait jamais existé. Winston décida qu’il ne serait pas suffisant de simplement inverser la tendance du discours de Tonton. Il serait mieux de le faire parler d’une chose absolument déconnectée du sujet d’origine.
Il pouvait transformer le discours en dénonciation habituelle des traîtres et des crimepenseurs, mais c’était un peu trop évident ; tandis qu’inventer une victoire sur le front, ou un triomphe de surproduction du Neuvième Plan Triennal, compliquerait inutilement les archives. Il fallait une pure invention. Soudain surgit dans son esprit, comme déjà prête, l’image d’un certain camarade Ogilvy, qui était récemment mort au combat, dans des circonstances héroïques. En certaines occasions, Tonton dédiait son Ordre du Jour à la commémoration d’un humble sous-fifre du Parti dont la vie et la mort devaient être tenues en exemple digne d’être suivi. Aujourd’hui, il commémorerait le camarade Ogilvy. Il n’y avait en réalité aucun camarade Ogilvy, mais quelques lignes imprimées et des montages photographiques le feraient bientôt exister.
Winston réfléchit un instant, puis tira le parlécrit vers lui et commença à dicter, dans le style de Tonton : un style à la fois militaire et pédant, et, à cause d’une manie de poser des questions pour y répondre tout de suite après (« Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces faits, camarades ? La leçon — qui est aussi un des principes fondamentaux de l’Angsoc — est que. . . » etc. etc.), facile à imiter.
À l’âge de trois ans, le camarade Ogilvy avait refusé tous les jouets sauf un tambour, une mitraillette et une maquette d’hélicoptère.
À six ans (un an plus tôt qu’autorisé, grâce à un assouplissement exceptionnel des règles) il avait rejoint les Infiltrés ; à neuf ans il avait été chef de troupe. À onze ans, il avait dénoncé son oncle à la Police des Pensées après avoir surpris une conversation qui lui avait semblé avoir des tendances criminelles. À dix-sept ans, il était devenu organisateur de quartier des Jeunesses Anti-Sexe. À dix-neuf ans, il avait dessiné une grenade à main qui avait été adoptée par le ministère de la Paix et qui, au premier essai, avait tué trente-et-un prisonniers eurasiens en une seule explosion. À vingt-trois ans, il avait 45
péri au combat. Poursuivi par des chasseurs ennemis en survolant l’océan Indien avec d’importantes informations, il avait lesté son corps avec sa mitraillette et s’était jeté de son hélicoptère dans les flots, emportant les informations avec lui — une fin, souligna Tonton, qu’il était impossible de contempler sans un sentiment d’envie. Tonton ajouta quelques remarques sur la pureté et le dévouement de la vie du camarade Ogilvy. C’était un abstinent complet et un non-fumeur, il n’avait d’autre divertissement qu’une heure quotidienne au gymnase, et avait fait vœux de célibat, considérant le mariage et la vie de famille incompatibles avec sa dévotion vingt-quatre heures sur vingt-quatre au devoir. Il n’avait d’autres sujets de conversation que les principes de l’Angsoc, et d’autres buts dans la vie que la défaite de l’ennemi eurasien et la traque des espions, saboteurs, crimepenseurs et autres traîtres.
Winston hésita à donner au camarade Ogilvy l’Ordre du Mérite Apparent : finalement, il trancha que non, à cause de l’inutile travail de référencement croisé que cela induirait.
Une fois de plus, il jeta un regard à son rival dans la cabine opposée.
Quelque chose lui disait avec certitude que Tillotson était occupé au même travail que lui. Il n’y avait aucun moyen de savoir quelle version serait choisie au final, mais il avait la profonde conviction que ce serait la sienne. Le camarade Ogilvy, inexistant une heure plus tôt, était maintenant un fait. Il lui sembla curieux de pouvoir créer des hommes morts mais pas des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n’avait jamais existé dans le présent, existait maintenant dans le passé, et quand l’acte de falsification serait oublié, il existerait aussi authentiquement, et avec les mêmes preuves, que Charlemagne ou Jules César.
46
C h a p i t r e V
Sous le plafond bas de la cantine, profondément enterrée, la file d’attente pour le déjeuner avançait lentement. La salle était déjà bondée et désagréablement bruyante. Des grilles du comptoir s’échappait la vapeur d’un ragoût dont l’âcre odeur métallique ne parvenait pas à masquer les effluves de Gin de la Victoire. De l’autre côté de la pièce se trouvait un bar, un simple trou dans le mur, où l’on pouvait acheter du gin pour dix cents le grand verre.
« L’homme que je cherchais », dit une voix derrière Winston.
Il se retourna. C’était son ami Syme, qui travaillait au département de la Recherche. Le mot « ami » n’était peut-être pas tout à fait exact. Vous n’aviez plus d’amis, seulement des camarades : mais il y avait des camarades dont la compagnie était plus plaisante que d’autres. Syme était un philologue, un spécialiste de la nouvelangue.
En effet, il faisait partie de l’énorme équipe d’experts dédiée à la compilation de la onzième édition du Dictionnaire de Nouvelangue.
C’était une petite créature, plus petite que Winston, aux cheveux sombres et aux grands yeux protubérants, à la fois mélancoliques et moqueurs, qui semblaient scruter intensément votre visage quand il vous parlait.
« Je voulais te demander si tu avais des lames de rasoir, dit-il.
– Pas une ! répondit Winston dans une hâte coupable. J’ai essayé partout. On n’en trouve plus. »
Tout le monde vous demandait sans cesse des lames de rasoir. En réalité, il en avait deux toutes neuves qu’il conservait précieusement.
La pénurie durait depuis plusieurs mois. Il y avait toujours un bien de première nécessité que les magasins du Parti ne parvenaient pas 47
à fournir. Parfois c’était des boutons, parfois de la laine à repriser, parfois des lacets ; en ce moment c’était les lames de rasoir. Vous ne pouviez vous en procurer, s’il y en avait, qu’en furetant plus ou moins furtivement chez la « concurrence ».
« Ça fait six semaines que j’utilise la même lame », ajouta-t-il, hypocrite.
La queue avança un peu. Une fois arrêté, il se retourna pour faire de nouveau face à Syme. Ils prirent tous les deux un plateau métallique graisseux depuis une pile au bord du comptoir.
« Tu es allé voir la pendaison de prisonniers hier ? demanda Syme.
– Je travaillais, répondit Winston, impassible. Je la verrai au ciné, je suppose.