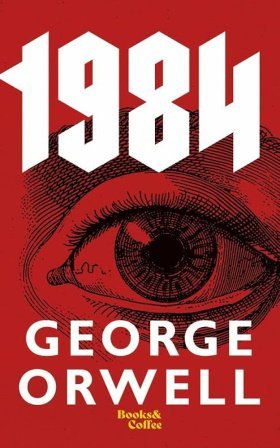quelconque poste subalterne, où l’intelligence n’était pas requise, mais à l’extérieur, c’était un membre important du Comité des Sports et de tous les autres comités engagés dans l’organisation de randonnées collectives, manifestations spontanées, collectes pour la campagne d’économies et autres activités volontaires. Il vous informait avec une certaine fierté, entre deux bouffées de sa pipe, qu’il s’était rendu à la Maison Commune tous les soirs de ces quatre dernières années. Une puissante odeur de sueur, sorte de témoin de son énergie dépensée, le suivait où qu’il allât, et persistait longtemps après son départ.
« Vous avez une clé à molette ? demanda Winston, la main sur l’écrou du syphon.
– Une clé à molette. . . répéta Mme Parsons, soudain devenue comme une larve. Je sais pas, je crois. Peut-être que les enfants. . . »
Il y eut un piétinement de bottes et un autre éclat de peigne quand les enfants chargèrent dans le salon. Mme Parsons ramena la clé à molette. Winston laissa s’échapper l’eau et enleva avec dégoût l’amas de cheveux qui avait bloqué le tuyau. Il nettoya ses doigts du mieux qu’il put avec l’eau froide du robinet et retourna dans l’autre pièce.
« Les mains en l’air ! » hurla une voix sauvage.
Un beau garçon de neuf ans, bien bâti, était apparu de derrière la table et pointait sur lui son faux pistolet automatique, tandis que sa petite sœur, d’environ deux ans de moins que lui, tenait la même posture avec un bout de bois. Les deux étaient habillés des shorts bleu, des chemises grises et des foulards rouges qui formaient l’uniforme des Infiltrés. Winston leva les mains au-dessus de sa tête, mais avec un sentiment d’inquiétude : le comportement du garçon était si vicieux que ce n’était peut-être pas complètement un jeu.
« Traître ! rugit le garçon. Tu es un crimepenseur ! Espion eurasien ! Je te tuerai, je te vaporiserai, je t’enverrai aux mines de sel ! »
Ils bondirent soudain autour de lui, criant « Traître ! » et « Crimepenseur ! », la petite fille imitant tous les gestes de son grand frère. C’était quelque peu effrayant, comme les galipettes de petits tigrons qui deviendront vite de dangereux mangeurs d’humains. Il y avait une sorte de férocité calculée dans le regard du garçon, un désir 23
évident de frapper ou taper Winston, et la conscience d’être presque assez costaud pour y arriver. Une bonne chose que son pistolet ne fût pas un vrai, pensa Winston.
Les yeux de Mme Parsons passèrent nerveusement de Winston à ses enfants, et inversement. Dans la lumière du salon, il constata avec intérêt qu’il y avait vraiment de la poussière dans les crevasses de son visage.
« Les garnements ! s’exclama-t-elle. Ils sont déçus parce qu’ils pourront pas aller à la pendaison. J’ai trop de boulot pour les emmener, et Tom va pas rentrer du travail à temps.
– Pourquoi on peut pas aller à la pendaison ? gronda le garçon de sa grosse voix.
– Veux voir la pendaison ! Veux voir la pendaison ! » reprit la petite fille, toujours en gambadant.
Winston se souvint que plusieurs prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devaient être pendus dans le parc ce soir. Ce spectacle, toujours populaire, avait lieu à peu près tous les mois. Les enfants réclamaient toujours d’y aller. Il prit congé de Mme Parsons et passa la porte. Il n’avait pas fait six pas dans le couloir que quelque chose lui heurta le cou, la douleur fut fulgurante. C’était comme si on lui avait enfoncé un bout de métal chauffé à blanc. Il se retourna juste à temps pour voir Mme Parsons traîner son fils à l’intérieur tandis que ce dernier rangeait un lance-pierre dans sa poche.
« Goldstein ! » beugla le garçon alors que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus Winston fut le regard de peur désespérée sur le visage grisâtre de la femme.
De retour dans son appartement, il passa rapidement devant le télécran et se rassit à sa table, toujours en se frottant le cou. La musique dans le télécran avait cessé. À la place, une voix martiale lisait, avec un appétit brutal, une description des armements de la nouvelle Forteresse Flottante qui venait de jeter l’ancre entre l’Islande et les Îles Féroé.
Avec ces enfants, pensa-t-il, cette pauvre femme devait vivre dans la terreur. Encore un an ou deux, et ils l’épieraient jour et nuit, guettant le moindre signe d’hétérodoxie. Quasiment tous les enfants, 24
maintenant, étaient horribles. Le pire était qu’à cause d’organisations comme les Infiltrés, ils étaient systématiquement transformés en petits sauvages ingouvernables, et pourtant cela ne leur donnait aucune envie de se rebeller contre la discipline du Parti. Au contraire, ils adoraient le Parti et tout ce qui lui était lié. Les chants, les processions, les banderoles, les randonnées, les entraînements avec des fusils factices, les slogans scandés, la vénération de Tonton — c’était une sorte de jeu grandiose pour eux. Toute leur férocité était canalisée vers l’extérieur, contre les ennemis de l’État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les crimepenseurs. Il était presque normal pour les personnes de plus de trente ans d’être effrayées par leurs propres enfants. Et à raison : il ne se passait pas une semaine sans que le Times ne publiât un paragraphe racontant comment un mor-veux sournois — un « enfant-héros » — avait surpris des paroles compromettantes et dénoncé ses parents à la Police des Pensées.
La douleur du lance-pierre était passée. Il reprit son porte-plume sans entrain, se demandant s’il pourrait trouver autre chose à écrire dans son journal. Il repensa soudain de nouveau à O’Brien.
Il y avait quelques années — sept ans, peut-être ? —, il avait rêvé qu’il traversait une pièce plongée dans l’obscurité. Et en passant, quelqu’un assis à côté de lui lui avait dit : « Nous devrions nous rencontrer là où l’obscurité n’existe pas. » C’était dit tranquillement, presque négligemment — une proposition, pas un ordre. Il avait continué sans s’arrêter. Le plus curieux était qu’à ce moment-là, dans le rêve, les mots ne l’avaient pas vraiment marqué. Ce ne fut que plus tard, et petit à petit, qu’ils commencèrent à prendre sens. Il ne se souvenait pas si c’était avant ou après ce rêve qu’il avait vu O’Brien pour la première fois, il ne se souvenait pas non plus quand il avait associé la voix à O’Brien. Mais dans tous les cas, il l’avait reconnu.
C’était O’Brien qui lui avait parlé dans l’obscurité.
Winston n’avait jamais pu déterminer — même après que leurs regards se fussent croisés ce matin — si O’Brien était un allié ou un ennemi. Cela n’avait au fond qu’assez peu d’importance. Il y avait entre eux un lien de compréhension, plus important que de l’affection ou de la camaraderie. « Nous devrions nous rencontrer là 25
où l’obscurité n’existe pas », avait-il dit. Winston ne savait pas ce que cela signifiait, mais d’une façon ou d’une autre, cela se réaliserait.
La voix dans le télécran marqua une pause. Un coup de trompette, cristallin et harmonieux, résonna dans l’air stagnant. La voix se fit stridente :
« Votre attention ! Votre attention s’il vous plaît ! Une dépêche vient d’arriver depuis le front du Malabar. Nos forces en Inde du Sud ont arraché une victoire triomphante. Nous pouvons officiellement considérer que les exploits que nous rapportons pourraient vraisemblablement amener la guerre un peu plus près de son terme. Dans le détail. . . »
Les mauvaises nouvelles ne tarderaient pas, songea Winston. Et effectivement, après une description sanglante du massacre de l’armée d’Eurasia, et des chiffes impressionnants de morts et de prisonniers, vint l’annonce que les rations de chocolat seraient réduites, à partir de la semaine prochaine, de trente à vingt grammes.
Winston rota à nouveau. Les effets du gin s’effaçaient, laissant place à un sentiment de vide. Le télécran — peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour faire oublier la diminution du chocolat —
joua l’hymne Océania, tout pour toi. Vous étiez supposé vous lever en réponse. Mais là où il était, personne ne le voyait.
Océania, tout pour toi fit place à une musique plus légère. Winston marcha jusqu’à la fenêtre. Le temps était toujours clair et froid.
Quelque part au loin, un missile explosa dans un grondement sourd.
Une vingtaine ou une trentaine tombaient sur Londres chaque semaine en ce moment.
Dans la rue, le vent battait toujours l’affiche, et le mot A n g s o c apparut et disparut opportunément. Angsoc. Les principes sacrés de l’Angsoc. La nouvelangue, le doublepense, la malléabilité du passé.
Il se sentit comme errant dans la flore des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux, où lui-même était le monstre. Il était seul. Le passé était mort, le futur inconcevable. Quelle certitude pouvait-il avoir que ne serait-ce qu’un seul être humain était de son côté ? Et comment savoir si la domination du Parti ne durerait pas pour toujours ? Comme une réponse, les trois devises sur la façade 26
blanche du ministère de la Vérité lui revinrent : L a g u e r r e c ’ e s t l a pa i x
L a l i b e rt é c ’ e s t l’ e s c l ava g e L ’ i g n o r a n c e c ’ e s t l a f o r c e .
Il sortit une pièce de vingt-cinq centimes de sa poche. Là aussi, en tout petit, les mêmes devises étaient inscrites, et l’autre face portait le visage de Tonton. Même sur la pièce, les yeux vous suivaient. Sur les pièces, sur les timbres, sur la couverture des livres, sur les banderoles, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes — partout. Toujours les yeux vous suivaient, toujours la voix vous enveloppait. Endormi ou éveillé, travaillant ou mangeant, dedans ou dehors, au bain ou au lit : aucune échappatoire. Rien ne vous appartenait, sinon les quelques centimètres cube dans votre crâne.
Le soleil avait tourné, et la myriade de fenêtres du ministère de la Vérité, qui ne réfléchissaient plus la lumière, étaient aussi sinistres que les meurtrières d’une forteresse. Son cœur vacilla face à l’imposante pyramide. Elle était trop solide, elle ne pouvait pas être détruite.
Un millier de missiles ne l’abattrait pas. Il se demanda à nouveau pour qui il écrivait le journal. Pour le futur, pour le passé — pour un temps peut-être imaginaire. Et devant lui se trouvait non pas la mort, mais l’annihilation. Le journal serait réduit en cendre, et lui-même, vaporisé. Seule la Police des Pensées lirait ses écrits, avant de les supprimer du monde et des mémoires. Comment pourriez-vous en appeler au futur quand aucune trace de vous, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier, ne survivra ?
Le télécran sonna quatorze heures. Il devait partir dans dix minutes pour être de retour au travail à quatorze heures trente.
Étrangement, la sonnerie sembla lui redonner de la vigueur. Il était un fantôme solitaire proférant une vérité que jamais personne n’entendrait. Mais tant qu’il la proférerait, d’une façon assez obscure, la continuité ne serait pas rompue. Ce n’était pas en se faisant entendre, mais en restant lucide que vous transmettiez l’héritage humain. Il retourna à sa table, encra son porte-plume, et écrivit : Au futur ou au passé, à un temps où la pensée est 27