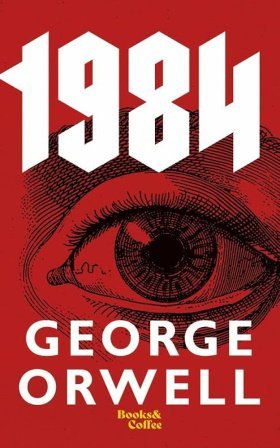était effectivement en train de cheminer dans la salle. C’était un homme rondelet, de taille moyenne, aux cheveux épars et au faciès de grenouille. À trente-cinq ans il avait déjà des bourrelets au cou et à la taille, mais ses mouvements étaient vifs et juvéniles. Il donnait l’impression d’être un petit garçon ayant grandi trop vite, si bien que même vêtu de la combinaison réglementaire, il était impossible de ne pas l’imaginer habillé du bermuda bleu, de la chemise grise et du foulard rouge des Infiltrés. En pensant à lui, on visualisait immédiatement des genoux croûtés et des manches relevées sur des avant-bras dodus. Il faut dire que Parsons enfilait son bermuda dès qu’une randonnée collective ou une autre activité physique lui en donnait le prétexte. Il les salua tous les deux d’un joyeux « Salut salut ! » et s’assit à la table, diffusant une intense odeur de transpiration. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage rosé. Ses pouvoirs de sudation étaient exceptionnels. À la Maison Commune, vous saviez s’il avait joué au tennis de table à la moiteur du manche de la raquette. Syme avait sorti un morceau de papier sur lequel se trouvait une longue liste de mots, et les étudiait, un stylo entre les doigts.
« Regarde-le faire des heures sup’ pendant le repas ! dit Parsons en donnant un coup de coude à Winston. Quel enthousiasme ! Qu’est-ce que c’est, mon vieux ? Un truc trop intello pour moi, j’ai l’impression.
Smith, mon vieux, si je te cherche, c’est pour la cotise que t’as oubliée de me donner.
– Quelle cotise ? » demanda Winston, cherchant instinctivement de la monnaie. À peu près un quart du salaire devait être réservé pour des cotisations volontaires, qui étaient si nombreuses qu’il était difficile de toutes s’en souvenir.
– Pour la Semaine de Haine. Tu sais, la caisse par bâtiment. Je suis le trésorier du quartier. On ménage pas nos efforts, ça va être du grand spectacle. J’te l’dis, ça sera pas ma faute si la Résidence de la Victoire n’a pas les plus gros drapeaux de toute la rue. Tu m’avais promis deux dollars. »
Winston trouva deux vieux billets sales et les tendit à Parsons, qui les nota dans un petit carnet, dans la belle calligraphie des illettrés.
54
« Au fait, mon vieux, dit-il, j’ai appris que ma petite canaille t’avait touché avec son lance-pierre hier. Je lui ai donné une bonne correction. Je lui ai même dit que je lui confisquerai son lance-pierre s’il recommence.
– Je crois qu’il était un peu en colère de ne pas avoir pu aller à l’exécution, dit Winston.
– Ah oui ? Je veux dire, c’est la bonne mentalité, hein ? Des petites canailles, tous les deux, mais tellement enthousiastes ! Ils ne pensent qu’aux Infiltrés, et à la guerre, bien sûr. Tu sais ce que ma fistonne a fait samedi dernier, quand sa troupe est partie en rando vers Berkhamsted ? Elle a pris deux autres filles avec elle et a quitté discrètement le groupe pour passer l’après-midi à suivre un type bizarre. Elles sont restées derrière lui pendant deux heures, à travers les bois, et, à Amersham, l’ont livré aux patrouilles.
– Pourquoi elles ont fait ça ? » demanda Winston, un peu stupéfait.
Parsons continua triomphalement :
– Ma fille s’est assuré que c’était un agent ennemi ou un truc du genre — il a pu être largué en parachute, par exemple. Mais attends, mon vieux. Tu sais ce qui l’a mise sur la piste ? Elle a vu qu’il portait des chaussures bizarres — elle a dit qu’elle avait jamais vu des chaussures comme ça avant. Donc y avait de fortes chances pour que ce soit un étranger. Pas mal pour une gosse de sept ans, hein ?
– Qu’est-ce qui est arrivé à l’homme ? demanda Winston.
– Ah ça j’en sais rien. Mais je serais pas surpris si. . . » Parsons fit semblant de mettre en joue avec ses bras, et claqua sa langue en appuyant sur la détente.
– Bien, dit Syme distraitement, sans lever les yeux de son papier.
– C’est sûr, on peut pas se permettre de prendre des risques, opina consciencieusement Winston.
– Je veux dire, on est en guerre », dit Parsons.
Comme une confirmation, un coup de trompette résonna du télécran au-dessus d’eux. Toutefois, ce n’était pas une proclamation militaire cette fois, mais une simple déclaration du ministère de l’Abondance.
55
« Camarades ! cria une enthousiaste voix juvénile. Votre attention, camarades ! Nous avons de glorieuses nouvelles pour vous. Nous avons gagné la bataille de la production ! Les bilans complets de production de toutes les catégories de biens de consommation montrent que le niveau de vie a augmenté de pas moins de vingt pourcents l’année passée. Ce matin, partout en Océania, il y a eu d’irrépressibles manifestations spontanées quand les travailleurs sont sortis de leurs usines et de leurs bureaux et ont paradé dans les rues, portant des banderoles proclamant leur reconnaissance envers Tonton pour l’heureuse et nouvelle vie dont sa sage direction nous gratifie. Voici quelques-uns des derniers chiffres. Nourriture. . . »
L’expression « heureuse et nouvelle vie » revint plusieurs fois.
Elle était à la mode en ce moment au ministère de l’Abondance.
Parsons, captivé par le coup de trompette, écoutait avec une sorte de solennité béante, un ennui éclairé. Il ne pouvait pas comprendre les chiffres, mais il avait conscience qu’ils devaient être source de satisfaction. Il avait sorti une énorme pipe sale qui était déjà à moitié remplie de tabac carbonisé. Avec le rationnement du tabac à cent grammes par semaine, il était rarement possible de remplir une pipe complète. Winston fumait une Cigarette de la Victoire, qu’il tenait avec précaution à l’horizontale. Les nouvelles rations n’arrivaient que demain et il ne lui restait plus que quatre cigarettes. Pour l’instant, il faisait abstraction du bruit environnant pour se concentrer sur le flot s’échappant du télécran. Apparemment, il y avait même eu des manifestations pour remercier Tonton d’avoir augmenté les rations de chocolat à vingt grammes par semaine. Mais hier seulement, songea-t-il, il avait été annoncé que les rations seraient réduites à vingt grammes par semaine. Était-il possible qu’ils avalassent ça, après seulement vingt-quatre heures ? Oui, ils l’avalèrent. Parsons l’avala facilement, avec la stupidité d’un animal. La créature sans yeux à l’autre table l’avala fanatiquement, passionnément, avec le désir furieux de traquer, dénoncer et vaporiser quiconque suggérerait que les rations de la semaine passée étaient de trente grammes. Syme, également — d’une façon plus complexe, impliquant le doublepense
— Syme l’avala. Était-il, alors, le seul en possession d’un souvenir ?
56
Les fabuleuses statistiques continuèrent à se déverser du télécran.
Comparé à l’année précédente, il y avait plus de nourriture, plus de vêtements, plus de logements, plus de meubles, plus de casseroles, plus de carburant, plus de bateaux, plus d’hélicoptères, plus de livres, plus de bébés — plus de tout, sauf de maladies, de crimes et de fous. Année après année, minute après minute, tout et tout le monde progressait à toute vitesse. Comme Syme l’avait fait plus tôt, Winston avait pris sa cuillère et jouait avec la pâle mixture qui dégoulinait sur la table, dessinant des formes avec la longue coulée. Il médita, amer, sur la texture de la vie. En avait-il toujours été ainsi ? La nourriture avait-elle toujours eu ce goût ? Il parcourut la cantine du regard. Une pièce au plafond bas, bondée, aux murs salis par le contact d’innombrables corps ; des tables et des chaises en métal cabossé, disposées si proches qu’assis, les épaules se touchaient ; des cuillères tordues, des plateaux défoncés, des tasses blanches grossières ; toutes les surfaces poisseuses, de la crasse dans tous les interstices ; et un aigre mélange d’odeurs de mauvais gin, de mauvais café, de ragoût métallique et de vêtements sales. Il y avait toujours dans votre estomac et dans votre chair une sorte de révolte, le sentiment que vous aviez été spolié. Il fallait admettre qu’il n’avait pas de souvenirs d’une situation sensiblement différente. D’aussi loin que remontait sa mémoire, il n’y avait jamais eu assez à manger, il n’y avait jamais eu de chaussettes ou de sous-vêtements sans trous, les meubles avaient toujours été cabossés et branlants, les pièces toujours sous-chauffées, les rames de métro toujours bondées, les maisons tombant toujours en ruine, le pain toujours noir, le thé toujours introuvable, le café toujours immonde, les cigarettes toujours rares — jamais rien d’abordable et d’abondant, à part le gin de synthèse. Et même si, bien sûr, ça empirait à mesure que le corps vieillissait, n’était-ce pas le signe que ce n’était pas l’ordre naturel des choses si votre cœur se retournait devant l’inconfort, la crasse et le dénuement, les hivers interminables, les chaussettes collantes, les ascenseurs toujours en panne, l’eau froide, le savon irritant, les cigarettes fragiles, et la nourriture au goût du diable ? Pourquoi quelqu’un trouverait-il cela intolérable s’il n’avait pas une sorte de mémoire ancestrale qu’un jour les choses avaient 57
été différentes ?
Il contempla à nouveau la cantine. Presque tout le monde était laid, et, même habillé autrement que de l’uniforme bleu, serait toujours laid. De l’autre côté de la pièce, assis seul à une table, un petit homme, ressemblant étrangement à un cloporte, buvait du café, ses petits yeux lançant des regards suspicieux de part et d’autre.
Comme il était facile de croire, songea Winston, si vous ne regardiez pas autour de vous, que le standard physique établi comme idéal par le Parti — des jeunes hommes musculeux et des jeunes filles à la poitrine généreuse, blonds, vigoureux, bronzés, insouciants —
existait et même prédominait. En réalité, à sa connaissance, la majorité des personnes à Aérozone Prime étaient petites, terreuses et maladives. C’était curieux comme les cloportes proliféraient dans les ministères : des petits hommes stupides, précocement corpulents, aux jambes courtes, aux mouvements saccadés, au visage boursoufflé et insondable et aux yeux minuscules. C’est le type qui semblait le plus prospérer sous la domination du Parti.
L’annonce du ministère de l’Abondance se termina sur un autre coup de trompette et fit place à une musique métallique. Parsons, parcouru d’un vague enthousiasme suite au bombardement de chiffres, sortit sa pipe de sa bouche.
« Le ministère de l’Abondance a fait du bon boulot cette année, hein, dit-il en hochant la tête d’un air entendu. Au fait, Smith, mon vieux, t’aurais pas des lames de rasoirs que tu pourrais me filer ?
– Pas une, répondit Winston. Ça fait six semaines que j’utilise la même.
– Ah. . . C’était juste au cas où, mon vieux.
– Désolé, dit Winston. »
Le cancanement de la table voisine, temporairement silencieux pendant la déclaration du Ministère, avait recommencé, plus fort que jamais. Pour une raison ou pour une autre, Winston pensa soudain à Mme Parsons, avec ses cheveux épars et la crasse dans les rides de son visage. D’ici deux ans, ses enfants l’auraient dénoncée à la Police des Pensées. Mme Parsons serait vaporisée. Syme serait vaporisé.
Winston serait vaporisé. O’Brien serait vaporisé. Parsons, quant à 58
lui, ne serait jamais vaporisé. La créature sans yeux à la voix d’oie ne serait jamais vaporisée. Les petits cloportes qui arpentaient les couloirs labyrinthiques des ministères — eux non plus ne seraient jamais vaporisés. Et la fille aux cheveux noirs, la fille du département des Fictions — elle non plus ne sera jamais vaporisée. Il lui semblait pouvoir instinctivement savoir qui survivrait et qui périrait : mais il ne pouvait pas dire ce qui faisait que vous survivriez.